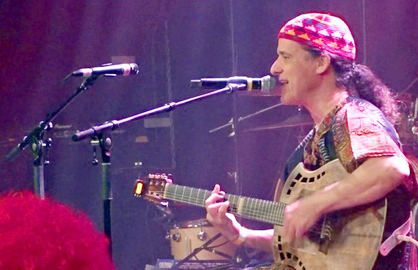Huit ans après «Death Magnetic», le groupe de hard rock américain publiera le 18 novembre «Hardwired… to self-destruct». Nous avons écouté en avant-première cet album très attendu. Et ça dépote!
Pas question de laisser fuiter quoi que ce soit avant le 1er novembre, ni à ses enfants ni même en confidence sur l’oreiller à sa fan légitime, pour la vingtaine de journalistes conviés à découvrir le nouvel opus de Metallica, «Hardwired… to self destruct» [«Programmé… pour s’auto-détruire»], dans les locaux d’Universal France. Et comme ici, on se méfie des enregistrements sauvages, chose compréhensible au pays de Patrick Buisson, les téléphones portables doivent donc être laissés au vestiaire.
Jusqu’à présent, seuls trois titres ont été livrés en pâture, dont le furieux «Hardwired», qui ouvre les hostilités, soit trois minutes de furie, un croisement de «Metal Militia» et de «Hit the Lights», les morceaux les plus dingues du premier album, le survitaminé «Kill’em All». Mais le naturel –qui veut que depuis «…And Justice For All» (1988), le groupe étire les morceaux jusqu’à plus soif– revient au triple galop avec «Atlas, Rise!», dévoilé lundi, puis «Now that we’re dead» qui regorgent d’idées, parfois biscornues ou jetées pêle-mêle. Les riffs s’enchaînent à une cadence digne de Michael Schumacher… au point aussi de laisser aussi une impression globale de fouillis.
Le premier morceau dévoilé, «Hardwired»
Le chant de James Hetfield est ultra-agressif, comme le prouve l’implacable «Moth Into Flame», autre titre déjà écoutable en ligne, un papillon de nuit à des années lumières de celui de France Gall. «Dream no more» modère enfin le rythme effréné mené jusqu’alors, avec un couplet langoureux. Il y aurait presqu’une invitation à se lancer sur la piste de danse au bras de sa belle, avant de l’envoyer bouler soudainement pour pogoter sur le refrain martial (si si, elle comprendra, je vous assure, Metallica pardonne bien des écarts). Un contraste très efficace avant le morceau le plus réussi de la première salve, «Halo on fire». Un titre qui sonne déjà comme un futur classique, où l’on se rappelle enfin que James Hetfield, a un registre vocal vraiment sensible et nuancé. Et que lorsqu’il ose en faire usage, il assure, sans jamais tomber dans la guimauve ou le slow métalleux dégoulinant. Mieux, on entend à nouveau un Kirk Hammett inspiré comme rarement, qui multiplie les solos ébouriffants. A la rythmique, Lars Ulrich et Robert Trujillo mènent pour leur part un train d’enfer. Pas de doute, alors que sonne la mi-temps, on comprend que nos quinquas nerveux ne sont toujours pas près au compromis commercial, n’en déplaise à André Rieu. Il est temps pour tous de prendre une bière, des chips, de laisser reposer les oreilles après 40 minutes électriques…
Le clip de «Moth Into Flame»
Les cardiaques peuvent sortir de la salle, au risque de l’accident fatal s’ils enchaînent illico sur la deuxième volée de six titres survoltés. Déboule alors le bien nommé «Confusion», avec sa batterie en ordre de marche militaire, du pur Metallica, un titre fait pour le live. On entrevoit déjà les light shows qui s’affolent et un public plongé dans une transe stroboscopique. Surgit alors la deuxième pépite d’»Hardwired… to self destruct», «ManUnkind» : intro harmonieuse, basse qui s’affirme et prend son indépendance (seul titre où d’ailleurs, l’excellent Robert Trujillo est crédité), un solo quatre étoiles de Kirk Hammett qui marque cet album de son empreinte, sauvant même les morceaux moyens. Rien à dire, l’humanité a beau n’être pas très sympa et Metallica prophétiser la IIIe guerre mondiale, on se réjouit du clash final comme un hédoniste savourant une piña collada sur un volcan en éruption.
Hetfield scande «born to lose live to win»
«Here comes the Revenge» déclenche les sirènes annonçant le prochain bombardement sonore. Mais l’intro longue, mais alors vraiment très très très longue, nuit à l’efficacité du morceau, qui redécolle heureusement quand James Hetfield entonne, en digne héritier de Caïn, sa chanson douce -»Sweeeet reveeenge !»- suivie d’un solo assassin de maître Hammett. Et là, Metallica nous pose enfin la question à 1000 euros : «Am I Savage ?» «Bah oui. Ça c’est vrai ça !» répond illico la mère Denis du fond de son tombeau. Pour ceux qui en douteraient encore, après une intro délicate, James hurle comme un loup garou. Et ce n’est pas «Murder one» qui va calmer la bête, plus sauvage que jamais après s’être échappée de sa cage moelleuse, une intro à la «Welcome home (Sanitarium»). Et de scander «Born to lose, live to win», dicton approuvé par Lemmy comme par Kennedy, qui dit grosso modo que dans la vie, mieux vaut ne pas se laisser abattre. Le headbanger commence à avoir mal au cou lorsque Metallica crache son ultime morceau, «Spit out the bone» : d’emblée, un batterie épileptique claque comme un coup de fouet encore plus cinglant que celui de «Whiplash», avant que lorsque le morceau s’énerve définitivement dans des envolées à la «One».
Metallica – «Atlas, Rise!»
«Bon alors, le verdict?» «Comment? Ai-je croisé Bénédicte? Diantre non ! En revanche, je peux vous dire qu’avec «Hardwired… to self destruct», vous en aurez vraiment pour vos sourds. L’album s’inscrit dans la droite lignée de «Death Magnetic», et possède déjà au moins deux classiques qui alimenteront les futurs best-of.
Pour atteindre le statut des albums cultes du groupe –les cinq premiers, dans l’ordre ou dans le désordre, selon vos goûts– il aurait cependant mérité d’être plus concis. Le trash metal progressif, cet oxymore musical qui marie furia de Motorhead et dilatement du temps à la Pink Floyd, est un genre assez casse-gueule qui implique d’être au top tout le temps, ici 80 minutes d’affilée. Mission quasi-impossible mais sommets que le groupe a tutoyés pourtant à plusieurs reprises. Moralité, «Hardwired…» ne s’autodétruira pas dans votre discothèque, mais mettra joyeusement le feu à vos esgourdes!