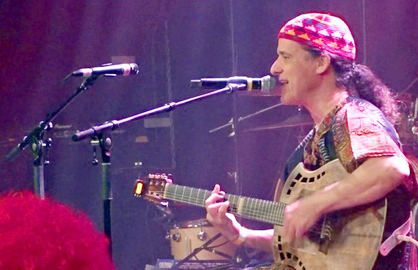En revenant au jazz, la fille de Ravi Shankar signe un retour aux sources inspiré.
Paris Match. Vos deux disques précédents étaient assez déroutants, plus portés vers la pop ou le rock.
Norah Jones. Peut-être ai-je perdu une partie de mon public en route, mais peut-être aussi ai-je gagné de nouveaux fans. C’est l’inspiration qui me pousse vers un genre plutôt qu’un autre. Il n’y a rien de préconçu, de préétabli. Quand je compose la ballade “It’s a Wonderful Time for Love”, je sais que ce sera une chanson parfaite pour un disque de jazz classique. “Day Breaks”, en revanche, je l’ai démarrée au piano et elle s’est terminée tout autrement. Il n’y a pas de règle.
Êtes-vous d’accord avec l’idée de retour aux sources pour ce nouvel album ?
Oui, un peu… Je voulais juste jouer de la musique, sans savoir spécialement où j’allais. Même si j’ai toujours l’intention d’aller de l’avant, pas de revenir en arrière.
Vous écrivez “Love is a shame, and then there was you » (l’amour est une honte, et puis tu es arrivé). Vous allez mieux ?
Je suis passée par une période compliquée au moment de mon précédent disque, que ce soit en amour comme en amitié. Mais c’est la vie… Certains de mes nouveaux morceaux sont autobiographiques car l’écriture peut être parfois thérapeutique. Mais en général j’aime parler de ce que je vois, du monde qui m’entoure, des choses de la vie.
En quoi le fait d’avoir un enfant a modifié votre écriture ?
Ce n’est pas vraiment l’écriture qui change, mais la perception que je peux avoir de mon travail. Certaines paroles prennent une nouvelle dimension. “And then there was you”, j’avais cette phrase depuis longtemps. Elle a enfin trouvé son sens.
Vous avez participé l’an passé à l’album de Keith Richards. Savez-vous pourquoi il vous a sollicitée ?
Absolument pas ! C’est toujours une énorme surprise quand on me fait ce genre de demande. Mais je ne cherche pas à savoir pourquoi on vient à moi. Je préfère vivre le moment, sans poser de questions. Keith voulait une voix féminine, je l’avais rencontré une ou deux fois auparavant, ce n’était pas si intimidant que cela. Je ne me suis pas infiltrée dans le club puisque j’y étais invitée.
« J’ai eu du mal à parler de mon père, c’est vrai, mais je n’ai jamais cessé de l’aimer »
Quand le succès vous est tombé dessus il y a quinze ans, comment avez-vous fait pour ne pas perdre pied ?
J’ai tout pris comme ça venait, j’étais jeune, je pensais peut-être au lendemain, mais certainement pas au surlendemain. Ce fut un vrai bouleversement, mais il se passait beaucoup de choses positives également. J’ai pris le parti d’en profiter tout en essayant de rester quelqu’un de bien. Il y a des jours qui étaient plus intenses que d’autres. Mais je ne regrette rien.
Même lorsque vous deviez parler de Ravi Shankar, votre père ?
Cela a pu créer pas mal de confusion dans l’esprit des gens, mais dans ma tête ma musique a toujours été très éloignée de la sienne. Je ne connais pas les codes de la musique indienne, contrairement à ma sœur [la musicienne Anoushka Shankar]. J’ai eu du mal à en parler, c’est vrai, mais je n’ai jamais cessé d’aimer mon père ni même de l’admirer.
Suivait-il votre carrière ?
Non, il était juste un père fier de sa fille. L’année de sa disparition, nous nous sommes beaucoup vus. Il avait des moments de lucidité, puis des moments où il était moins disponible. Mais j’ai été le plus présente possible sur la fin de sa vie. Même si, le jour de sa mort, j’étais en tournée. Cela m’a aussi permis de me rapprocher de ma sœur, maintenant que nous avons toutes les deux fondé une famille. Elle vit à Londres, je suis à New York, mais nous sommes plus proches que jamais.
Que pensez-vous de Beyoncé ou Rihanna, incarnations du girl power actuel ?
Elles sont tellement loin de ce que je fais… Mon travail ne consiste pas à parler de leur musique. Juste de la mienne…