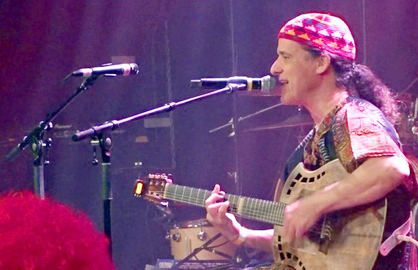Ecrit-on en deux langues ? Qu’est-ce que le roman ? Questions lancinantes qui, tout au long de la conférence-débat organisée dernièrement à la maison de la culture par le docteur Amine Zaoui, sont revenues. Mais d’autres, comme l’écriture, la lecture, la place du profane et du sacré dans la littérature, et spécialement dans la littérature magrhébine, celle de la liberté d’expression ont été également abordées, mais de façon subsidiaire et parce qu’éclairant les deux principales questions posées préalablement. Suivons le cheminement de la pensée d’un des plus grands romanciers et essayistes algériens.
La conférence débute par cette interrogation : «Peut-on écrire en deux langues ?» Et répondant par l’affirmative, le conférencier a cité le cas d’écrivains s’étant servi tour à tour de la langue maternelle et de la langue étrangère. À ce propos, l’écrivain égyptien Khalil Djebrane lui a, tout naturellement paru le modèle par excellence du genre, ayant rédigé son meilleur livre en anglais. Le problème pour le docteur Zaoui n’est pas dans cette forme de snobisme à laquelle cèdent trop facilement certains écrivains et qui leur fait souvent préférer le français à l’arabe. S’élevant en champion, à cet égard, il a pris soin de relever que cette langue, si décriée, par ailleurs par certains, est belle et moderne. La preuve, c’est que dans la douzaine de livres que l’un des auteurs les plus prolixes de sa génération a produit, la plupart le sont en arabe. Pourvu que l’on maitrise l’une et l’autre langue, il ne voyait absolument aucun inconvénient à ce que le jeune écrivain emploie indifféremment l’une ou l’autre, selon l’inspiration du moment.Non, s’il y a un problème avec la langue arabe, l’auteur d’El-Malika, dernier roman paru en 2014, l’attribue à l’usage qui en est fait par certains écrivains. Leurs attaques virulentes dirigées contre les juifs et les autres religions lui auraient causé beaucoup de tort, à son avis. Et comme pour marquer ses distances vis-à-vis de cette littérature, il a laissé éclater son indignation. Heureusement, et il s’en félicitait ouvertement, les écrivains de la jeune génération rectifient le tir. Ils écrivent dans un style plus relevé et plus respectueux de la déontologie, évitant de tomber dans la trivialité et l’invective. C’est dans ce sens strict que devrait être compris : la langue arabe qui véhicule une certaine forme de subversion concourt à la formation de mauvais lecteurs, aspect souligné lors de cette rencontre de l’écrivain avec le public. Aujourd’hui, selon l’essayiste, l’arabe et le français font de l’ombre à langue amazighe. Prise en sandwich entre elles, elle devenait inaudible, à tel point qu’un jour lui ayant posé la question de savoir qui du français ou de l’arabe était la victime de l’autre, le romancier avait répondu volontiers tamazigh. Quant au français qui peut soulever des cas de conscience patriotique, tout en se plaçant dans le sillage de Kateb Yacine, il a administré la preuve par neuf que cette langue est un « butin de guerre ». Et pour conclure, en fin rhétoriqueur, il n’a trouvé de mieux que cette phrase, qui devrait figurer dans quelque anthologie de textes littéraires : «deux langues, c’est deux ailes.» Permettez-moi, cher, maitre, qu’avant d’aller plus loin, je fasse deux remarques.
La première a trait à cette fameuse expression «deux ailes». Les écrivains qui ont écrit dans une seule langue ont-ils, donc, volé moins haut ? Les Corneille, Racine, Molière, Voltaire, Musset, Hugo, Lamartine, Gide, Mauriac, et Malraux, privés de l’autre aile, ne s’élevaient-ils de terre que pour retomber aussitôt? Cette même relation avec la langue que vous qualifiez de sentimentale, de charnelle ne s’en trouverait-elle pas mise à mal, dès lors qu’on passe d’une langue à l’autre ? N’admettiez-vous pas vous-même que la traduction est toujours inférieure à l’œuvre traduite ? Et écrire dans deux langues, qu’est-ce, sinon faire une «traduction» qui, pour se passer au niveau de la pensée et du subconscient n’en est pas moins une ? Il est vrai que vous êtes l’exemple du parfait bilingue, aussi à l’aise dans l’arabe que dans le français.
La soumission, un livre paru en 2002, tiré à 24 000 exemplaires en quatre jours et traduit en douze langues est un puissant plaidoyer en faveur de votre thèse. Mais ladite thèse est battue en brèche, dès qu’il ne s’agit plus de vous et de votre œuvre, mais d’écrivains qui ont jeté tout leur temps et toute leur force dans l’apprentissage et la maitrise d’une langue étrangère. Je m’étonne presque que le cas d’un Tolstoï ne se soit pas encore présenté à votre esprit. Comment lui, qui a pu préférer Corneille à Racine, alors que la France entière le situait très bas par rapport à l’auteur de Bérénice, qui trouvait le Nicolas Breugnon de Romain Rolland bien meilleur encore que Jean Christophe et tout ce que ce grand écrivain français avait écrit, comment Tolstoï maitrisant parfaitement le français, selon votre mot, n’aurait-il pas cédé à la tentation d’écrire lui-même Guerre et paix ou Anna Karénine en français ? Permettez, pour vous répondre sur ce point, que je fasse un emprunt à Régis Debray, prix Goncourt et membre de cette Académie. Voici ce qu’il dit de la langue, et qui se trouve dans L’indésirable, page 98 : l’étranger «peut-il à volonté partager cette obscure complicité tribale inscrite à son insu dans le corps de chaque rejeton de la tribu, qui habite sa bouche et sa moelle épinière, avant même son premier balbutiement et qui imprégnera tous ses mots et gestes jusqu’à sa mort-leur donnant haleine, parfum, couleur, ce sens d’au-delà du sens…». Comment une pareille alchimie alliant «haleine, parfum et couleur» pouvait-elle s’opérer chez un étranger à un pays, à une langue, à une culture ? Comment de telles essences (haleine, parfum, couleur) pouvaient-elles précéder chez lui l’existence de tout langage articulé, si déjà une autre langue les lui a révélées ? N’est-ce pas la preuve que quelles que soient ses dispositions naturelles, celles-ci fussent-elles extraordinaires, la maitrise d’une langue étrangère, ainsi que Franck, le héros de l’Indésirable, parti de Suisse faire la Révolution au Chili, le ressent, reste problématique ?
De grâce, maître, continuez à faire l’exception dans un domaine où vous excellez : écrivez à tour de bras en français et en arabe, mais, pour l’amour du ciel, maître, ne demandez pas à ceux qui n’ont ni votre talent, ni votre intelligence de vous suivre sur ce sentier de la gloire où il y a tant d’embuches. Ne leur faites pas jouer le triste rôle d’Icare. La cire de leurs ailes n’est pas faite pour supporter la température de tels sommets. Le deuxième point se rapporte au fameux mot de Kateb Yacine : «le français est un butin de guerre.» Si je ne partage pas ce point de vue, ce n’est pas d’aujourd’hui seulement. Un long débat m’a opposé déjà à tous ceux profs ou autres qui me l’ont sorti à l’occasion.
D’abord peut-on parler d’une chose imposée de force par l’occupant comme un butin ? Par butin n’entend-on pas tous ces biens que l’on prend dans une incursion en territoire ennemi ? Le dictionnaire est clair là-dessus. Et je l’ai tellement consulté à ce sujet dans l’espoir de lui trouver un autre sens, en vain. Je n’ai même plus besoin de le consulter en cet instant pour en vérifier l’acception. Je récite par cœur la définition qu’il donne.
Est-ce approprié de parler de butin à propos du français ? Dans toutes les histoires du monde l’occupant impose sa langue, ses lois, sa religion, ses mœurs. La France coloniale n’a pas failli à la règle. Dans un pays comme le nôtre, où le français a supplanté la langue maternelle (arabe ou tamazigh), est-il judicieux de parler de butin ? Que dirait Kateb s’il voyait que le français se parle toute la journée dans les rues, dans les cafés, sur les places publiques, dans les réunions de travail, en famille ?
En patriote convaincu, ne parlerait-il pas plutôt d’une écharde dans le pied de l’Algérien ?Voici une anecdote qui en dit long sur ce cadeau empoisonné fait par la France coloniale aux algériens. Un jour une enseignante du primaire s’est crue autorisée à donner à ses élèves un texte ayant pour titre : Pierre, un élève surdoué. L’inspecteur a demandé alors à la maitresse d’école de remplacer Pierre par le prénom d’un de sa classe. Elle a répondu qu’elle n’avait aucun problème avec les noms étrangers. Elle ne voyait pas ce que son texte véhiculait comme message : un complexe d’infériorité par rapport à l’ancien occupant ! Ses élèves grandiraient avec le sentiment que les surdoués c’est toujours Pierre et consort.
Je répondrais ici ce que j’ai répondu dans un article à cette enseignante : il faut faire attention à ce que le butin de guerre ne prenne pas toute la place de notre culture et de nos valeurs. Ecrire en français est un droit. Le faire au dépend de la langue nationale est un danger. La deuxième question que vous posez est la suivante : qu’est-ce que le roman ? Et pour vous le roman pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Et vous ajoutez, c’est ma philosophie du roman. Vos romans, certes. De la soumission, qui décrit la condition de la femme arabe, à El Malika, votre dernier roman qui, comme celui de Michel Houellebecq est basé sur un prédiction, (encore une coïncidence qui montre combien cet écrivain est si proche de vous ou vous de lui), on désespérerait de vous prendre en défaut. Là, maître, vous êtes dans votre élément, c’est-à-dire le roman à thèse. Mais qu’en est-il du roman réaliste, naturaliste, historique, psychologique, le roman d’action, le nouveau roman ?
Sans compter le roman policier qui prend de plus en plus de place dans la littérature moderne (je cite à cet égard Houellebecq, Philipe Ruffin etc..), le roman de sciences fiction, d’anticipation ? Vous avez signalé, à juste titre, dans votre conférence, que la culture c’est ce qui manque le plus chez nous et vous avez affirmé que le vrai défi qui nous attend est d’abord celui-là : semer les graines de cette plante miraculeuse qui fera un jour notre force et notre prospérité face aux autres nations. Eh bien, et là, je vous rejoins tout à fait, cher maître, lorsque vous dites que l’écrivain et le lecteur sont liés par des liens puissants pour relever ce défi du siècle, et bien, maître, le roman est la clef de voûte de cette culture que je qualifierais de masse.
C’est par la production du beau, du grand, du merveilleux, du rêve, de l’espoir que le roman nous rend le goût de la vie ; c’est à travers la peinture de nos mœurs et de nos traditions que nous prendrons conscience de notre identité et de notre destin.
Le roman éduque, le roman instruit, le roman inspire, élève et fortifie notre pensée. Le roman brise les carcans de l’ignorance et des superstitions. Et vous constaterez, cher maître, que c’est, une fois de plus, en plein accord avec vous que je conclu cette trop longue missive en me référant à vos propres mots.
Ali D.