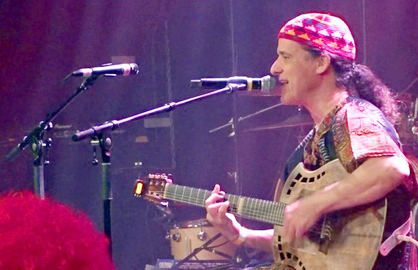Dans la filmographie de Tarantino, son huitième film appelle plus que jamais les superlatifs : le plus abouti, le plus beau, le plus sombre, le plus pessimiste. Mais certainement pas le plus cool.
A première vue, Les Huit Salopards ressemble à un film-somme qui opèrerait la synthèse de tout ce que Tarantino a déjà fait, et certains ne vont pas manquer de compiler les motifs récurrents, arguant que tel plan vient de Reservoir Dogs, tel autre d’Inglourious Basterds. De fait, on est en terrain familier, tous les ingrédients qui font la signature de QT sont au rendez-vous : les dialogues virtuoses, la direction d’acteurs, le mariage idéal de la musique et de l’image. En plus, il a obtenu des moyens à la hauteur de ses ambitions : il s’est enfin assuré la collaboration d’Ennio Morricone, qui lui a composé une partition à dominante de cordes et à la tonalité beaucoup plus proche du thriller horrifique que du western. Il s’est aussi payé le luxe de tourner en 70mm au format Ultra Panavision, un ratio exceptionnellement large, mais qui assure un tel confort de vision qu’il donne l’impression d’avoir toujours été la norme. Robert Richardson l’utilise magistralement, non seulement en extérieurs pour mettre en valeur de vastes paysages, mais aussi en intérieur pour définir l’espace avec précision et scruter les personnages en gros plans.
Huis presque clos
Mais derrière la surface rutilante, on observe une évolution majeure qui place ce huitième film au-dessus de tout ce que QT a fait jusqu’à présent. Le cinéaste a mûri et il a fortement réfréné certains de ses excès de jeunesse (l’ironie ricanante, le second degré) pour traiter d’un sujet sérieux – comment survivre en Amérique quand on est noir ou femme. Il a choisi une forme hybride qui remonte au classicisme de Howard Hawks par le biais de John Carpenter (en passant par Les dix petits nègres d’Agatha Christie), le tout situé dans le contexte de l’après-guerre de Sécession. L’action a lieu en terrain neutre (ni au Nord, ni au Sud), dans une auberge isolée où huit personnages ont trouvé refuge alors qu’une tempête de neige fait rage. Ils ont toutes les raisons de se méfier les uns des autres : hommes de loi contre possibles hors-la-loi, Blancs contre Noirs, anciens confédérés contre anciens nordistes. L’un d’eux, Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson), est un chasseur de primes, en route pour la ville voisine de Red Rock afin de livrer les cadavres de deux malfrats recherchés. John Ruth (Kurt Russel) est un autre chasseur de primes, qui traîne avec lui sa prisonnière Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), condamnée à la pendaison. Avec eux Chris Mannix (Walton Goggins), ancien confédéré et futur shérif de Red Rock. Face à eux, un bourreau anglais (Tim Roth), un Mexicain fourbe (Demian Bichir), un voyageur mutique (Michael Madsen), et un général en retraite de l’armée sudiste (Bruce Dern).
Ce huis presque clos (un dysfonctionnement de la porte d’entrée donne lieu à un gag récurrent) rappelle La chose de John Carpenter. Dans l’un et l’autre film, Kurt Russel sent que quelqu’un n’est pas qui il prétend être, et il entend bien le démasquer. L’enquête prendra des détours complexes et imprévisibles, selon une narration très tarantinienne, qui consiste parfois à répéter les mêmes scènes pour leur donner différentes significations. C’est un peu sa version du Rashomon de Kurosawa. Au fil des discussions, un motif capital se révèle, celui du mensonge, qui surpasse celui de la vengeance et prend une importance particulière dans cette intrigue où tout le monde dissimule son identité ou ses intentions. En virtuose des dialogues, Tarantino a développé une rhétorique de la tromperie comme révélatrice de vérité autant que moyen de parvenir à ses fins.
La revelation Goggins et l’hommage à Jason Leigh
Les acteurs s’en délectent et tous y trouvent l’occasion de briller. La part du lion revient à Samuel L. Jackson, dont les intonations, le phrasé et la rythmique sont devenus des éléments indissociables du cinéma de Tarantino. La musique du langage sert aussi à distinguer chacun des personnages : Kurt Russel parle comme John Wayne, Tim Roth accentue ses anglicismes, et Damien Bechir sa mexicanité (c’est vrai aussi pour les personnages secondaires comme la Néo-zélandaise Zoe Bell qui joue… une Néo-zélandaise). Comme souvent, Tarantino révèle un talent : cette fois, c’est le tour de Walton Goggins, qui passe du statut de second rôle pittoresque dont on ne se rappelle jamais le nom à premier rôle qu’on ne pourra plus jamais ignorer. Il parle avec une fausse candeur et un accent du sud qui font des merveilles. Incidemment, les doubleurs de la VF vont avoir un mal de chien à rendre toute la richesse thématique et musicale de réparties comme « Cut my legs off, and call me Shorty! » Une autre bénéficiaire est Jennifer Jason Leigh, dans un rôle qui semble avoir été écrit comme un hommage à sa carrière passée à prendre des coups, et dont elle s’acquitte avec une sorte de joie mauvaise.
Le crépuscule des odieux
On a souvent reproché à Tarantino de s’écouter écrire des dialogues, et ceux-ci occupent une bonne partie de la durée exceptionnellement longue du film. Mais la présentation road show, avec son intro et son entracte aux 2/3 (comme dans 2001 L’Odyssée de l’espace ou Il était une fois en Amérique) laisse le film défiler à un rythme naturel.
Autrement dit, on ne voit pas le temps passer (et on ne peut que conseiller de voir le film dans ce format).
Les deux premiers tiers servent à faire monter la tension qui se libère à la fin dans une orgie d’action d’une intensité éclaboussante.
C’est dans cette dernière partie que le film change de registre et convoque un autre film de Carpenter, Assaut (accessoirement un remake de Rio Bravo de Howard Hawks). Chez Carpenter, le bien s’associe au mal pour combattre le pire. Ici aussi, les circonstances obligent les protagonistes à choisir leur camp et à former des alliances inattendues.
Sauf que chez Tarantino, il n’y a aucun personnage positif (ou alors, ils sont morts). Le Bien n’a plus sa place, il n’y a que des nuances de Mal.
Le moins odieux des personnages est seulement raciste et misogyne. Il en ressort un tableau particulièrement sombre de l’Amérique, où seul le mensonge permet d’arriver à ses fins, où seul l’argent permet de rendre la « justice » et de faire régner l’ordre, où la vie humaine n’a aucune valeur (mort ou vif, la récompense est la même), et où la liberté s’arrache par les armes et par la violence.
Tarantino a écrit un de ses films les moins cool, dans lequel la violence n’est plus un motif de plaisir mais de réflexion liée à son sujet et à ses retombées : la brutalité envers les Noirs américains est toujours d’actualité aujourd’hui.
Et s’il y en a que la sauvagerie graphique du film peut choquer, qu’il leur suffise de se rappeler Henry Fonda massacrant de sang froid une famille entière dans Il était une fois dans l’ouest pour voir que Tarantino n’est pas tellement plus sanglant que Sergio Leone.
Il serait flatté d’être placé au même niveau. Et on peut hasarder que Hateful Eight a d’ores et déjà sa place parmi les grands classiques américains.