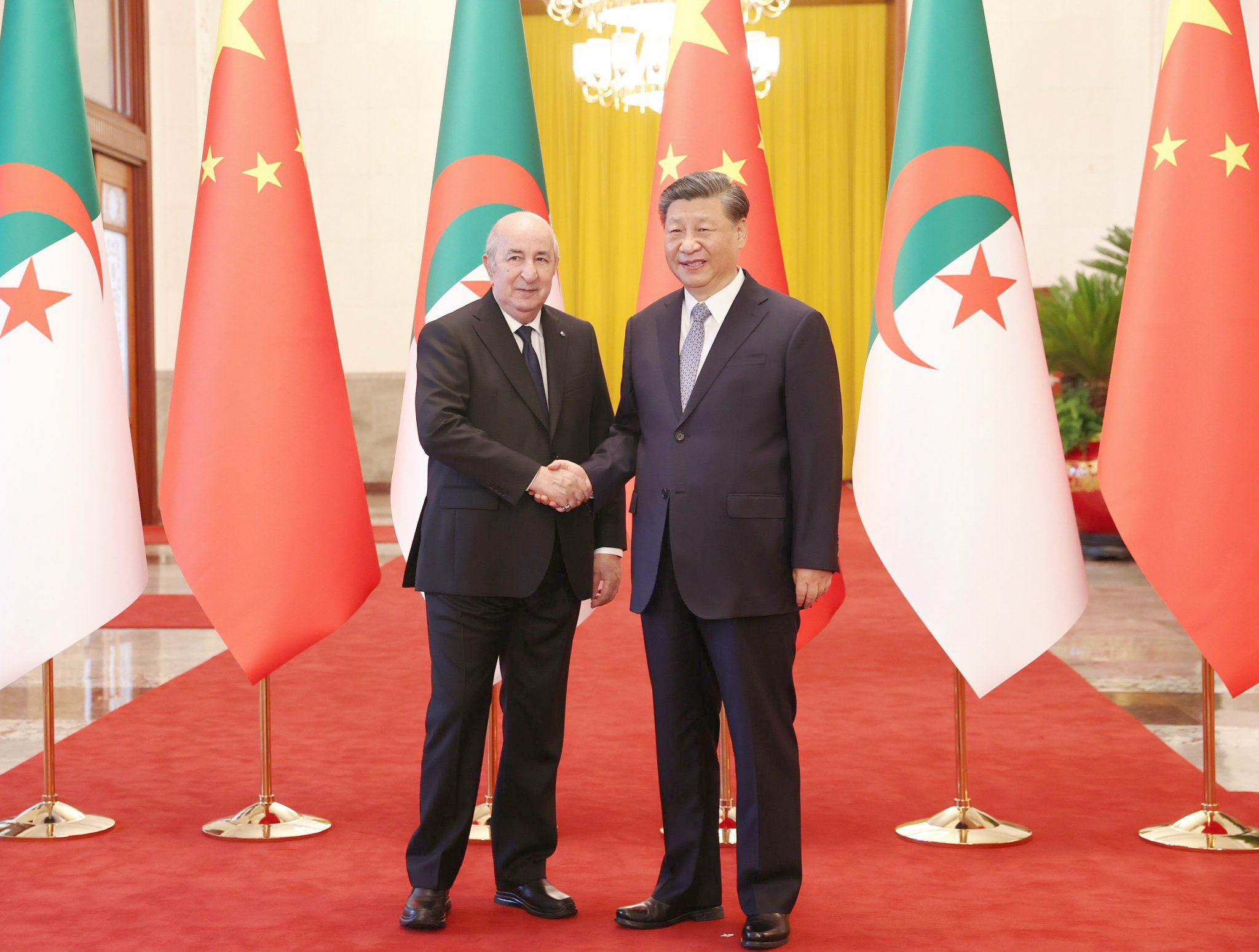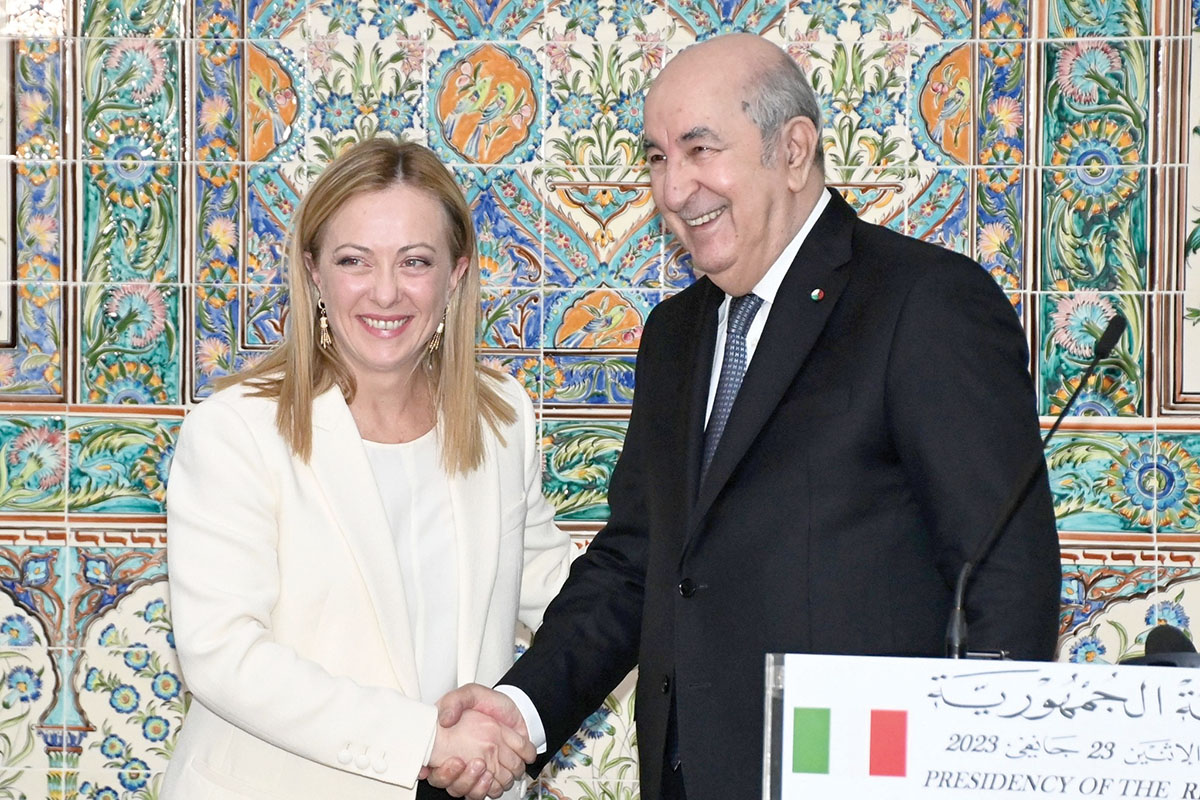à «mini-Kaboul», un marché de Peshawar, la capitale du Nord-Ouest pakistanais, tout rappelle l’Afghanistan. Les vendeurs en sont tous originaires, à l’instar des millions de réfugiés afghans vivant au Pakistan, certains depuis maintenant quatre décennies. Des enfants afghans poussent des chariots de fruits. Le dari, l’une des principales langues afghanes, inusitée au Pakistan, est omniprésent.
Le «kabuli palao», plat national afghan, un riz assaisonné garni de viande, est roi. «Nous avons passé une vie entière ici», observe Niaz Mohammed, un travailleur journalier de 50 ans originaire du Nangarhar, province de l’Est afghan frontalière avec le Pakistan. Lui affirme avoir fui son pays dans les années 1980, alors que l’Afghanistan s’embrasait après l’invasion soviétique de Noël 1979. Quarante ans et des dizaines de milliers de morts plus tard, la violence ne s’est toujours pas atténuée. «Nous avons eu des mariages ici, nos enfants sont nés ici. (…) Nous travaillons ici, alors qu’il n’y a pas de paix en Afghanistan, poursuit Niaz Mohammed. Nous sommes heureux ici.» Lundi, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, en visite pour trois jours au Pakistan, à salué «l’énorme générosité» des Pakistanais, qui «n’ont pas seulement ouvert leurs frontières», mais aussi «leurs maisons et leurs cœurs» aux Afghans. Car le Pakistan est l’un des plus grands pays d’accueil au monde, avec 2,7 millions de réfugiés afghans, enregistrés ou sans papiers, selon Islamabad. Beaucoup vivent dans des camps, tandis que d’autres se sont construit une nouvelle vie, davantage insérés dans l’économie pakistanaise.
Suspicion
A «mini-Kaboul», les 5.000 échoppes sont tenues par des Afghans. Mais leur statut a toujours été temporaire. Les autorités fixent régulièrement des dates limites pour leur départ du Pakistan, qu’elles repoussent à mesure que le conflit s’aggrave en Afghanistan. De nombreux Pakistanais considèrent ces réfugiés avec suspicion, les soupçonnant d’encourager l’extrémisme et la criminalité, et demandent qu’ils soient renvoyés chez eux. Lundi, le deuxième vice-président afghan Sarwar Danish a également accusé des groupes insurgés de se servir de camps de réfugiés au Pakistan comme de «camps d’entraînement» pour combattants actifs en Afghanistan, ce que nie Islamabad. «Il n’y a pas de sanctuaire (pour extrémistes, NDLR) ici», lui a répondu le Premier ministre pakistanais Imran Khan. Au quotidien, les Afghans du Pakistan vivent en citoyens de seconde classe. Même ceux qui ont passé des décennies dans le pays ne peuvent posséder de terres ou une voiture. Très récemment, ils ont obtenu le droit d’ouvrir un compte bancaire. Peu après son arrivée au pouvoir mi-2018, Imran Khan avait indiqué vouloir leur accorder la citoyenneté pakistanaise. Mais l’indignation avait été si forte que la mesure est depuis lors enterrée. Nombre de réfugiés interrogés par l’AFP à Peshawar affirment malgré tout bien se sentir dans leur pays d’adoption. Javed Khan, 28 ans, est né au Pakistan. Il s’est marié à une Pakistanaise, avec qui il a eu trois enfants. «Je ne partirai que si le Pakistan m’y force», assure-t-il. La situation pourrait évoluer, alors que Donald Trump a récemment assuré qu’un accord était «très proche» entre Etats-Unis et talibans, permettant aux troupes américaines de se retirer d’Afghanistan en échange de garanties sécuritaires des insurgés. Ceux-ci,dans un second temps, doivent discuter avec le gouvernement de Kaboul, dont ils n’ont jamais reconnu la légitimité.
«Je ne veux pas revenir»
Les deux parties n’en ont qu’après «leur propre intérêt», commente Mohammed Feroz, dubitatif quant à l’impact qu’un tel accord aurait sur sa vie. «Personne ne se soucie de nous. Pour nous, Dieu est le seul espoir», poursuit ce propriétaire d’un négoce d’habits dans «mini-Kaboul», arrivé à il y a 40 ans au Pakistan. Même si la paix arrivait finalement, la plupart des réfugiés disent vouloir rester au Pakistan, car les opportunités économiques y sont meilleures. Dans le camp de Khurasan, à la sortie de Peshawar, environ 5.000 Afghans vivent dans le dénuement. Yaseen Ullah, 26 ans, sa mère et ses huit frères et sœurs, y partagent une petite maison en pisé de deux pièces sans eau courante. Malgré la dureté de leur vie, ils ne souhaitent pas non plus rentrer en Afghanistan. Là-bas, «je n’ai pas de travail. Qu’est-ce que j’y ferai?», questionne ce chiffonnier de 26 ans. Niaz Mohammed, père de sept enfants, tous nés dans un camp de réfugiés et qui parlent la langue pachtoune avec un accent pakistanais, est au diapason car il doit selon lui «nourrir (sa) famille». «Je le dis du fond du cœur, je préfère rester ici, confesse-t-il. Je ne veux pas revenir».