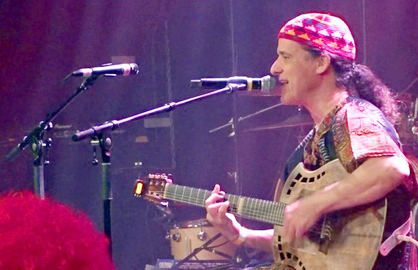Malek Haddad, le romancier, poète et journaliste, est un exilé éternel ou un insatisfait impénitent balloté entre deux cultures, la culture de la Mère et celle d’adoption qui lui servait à s’exprimer, y compris sur cette douleur.
Par Ali El Hadj Tahar
Malek Haddad a plus que quiconque vécu l’inextricable conflit linguistique entre la langue française, qu’il aimait, et la langue arabe, qu’il ne maitrisait pas mais qu’il adorait. Ce conflit prend des proportions dramatiques chez l’auteur de L’élève et la Leçon, où il fait à dire l’un de ses personnages : « L’histoire a voulu que j’ai toujours été à cheval sur deux époques, sur deux civilisations ». Né le 5 juillet 1927 au quartier de Faubourg Lamy à Constantine, Malek Haddad quitte Constantine après ses études secondaires et s’installe en France, à Aix-en-Provence, où il entame des études de droit qu’il abandonne rapidement. Il ne tarde pas à revenir en Algérie, où il milite au sein du Parti communiste algérien (PCA). En 1955, il est contraint à l’exil et regagne la France.
Il y rencontre Kateb Yacine et M’Hamed Issiakhem pour former ce que Mohammed Harbi appellera dans ses Mémoires «le trio infernal». Pour subvenir à ses besoins, à cette période, Malek Haddad fera plusieurs métiers dont ouvrier agricole, en compagnie de Kateb Yacine, dans le nord de la Camargue.
Puis il travaille à la radiodiffusion française et collabore à plusieurs revues, notamment Entretien, Progrès, Confluent, Les Lettres françaises. C’est aussi durant cette période de la guerre, entre 1956 et 1961, que se situe l’essentiel de ses publications, romans, recueils de nouvelles et poésie. Haddad effectuera aussi différentes missions au nom du FLN pour porter dans différents pays la voix de l’Algérie combattante. L’indépendance le rappelle au pays, où il collabore à la création de la presse nationale, notamment en faisant partie du comité de rédaction de Novembre et en tant que chef de rubrique, à Constantine, de la page culturelle d’An-Nasr (1965-1968). Il ne tarde pas à mettre fin à ses ambitions littéraires, considérée comme un suicide par certains tant cet écrivain était prometteur et talentueux. Il s’engage alors dans la politique et assume plusieurs postes de responsabilité, d’abord en tant que directeur de la culture au ministère de l’Information et de la Culture (1968-1972), puis en qualité de secrétaire général de l’Union des écrivains algériens (1974-1976) puis de conseiller technique chargé des études et des recherches dans la production culturelle en français dans le même ministère (à partir de 1972). Haddad est l’auteur de quatre romans. La dernière impression, sa première fiction, publiée en 1958.
Dans une ville imaginaire à laquelle l’auteur donne le nom de Constantine, Saïd, l’ingénieur, vient de terminer la construction d’un pont, permettant aux populations rurales d’économiser du temps sur 60 km de chemins difficiles. Son frère, Bouzid est au maquis, engagé dans la lutte armée, et il est convaincu que les ponts construits (dont ceux par Saïd) doivent être minés. Lucia, l’enseignante provençale arrivée depuis peu en Algérie, est tombée amoureuse de Saïd mais elle ne tarde pas à perdre la vie en recevant une balle perdue lors d’un «accrochage» en ville entre les moudjahiddines et l’armée française. Il y a aussi Chérif, le beau-frère, un petit fonctionnaire bien «assimilé» qui veut s’installer en France malgré le refus de son épouse.
Cette chronique d’une guerre qui commence pose avec acuité des problèmes de choix et de positions irréconciliables. Ce sont les dilemmes qui tiraillent Saïd : d’ailleurs, a-t-il le choix de refuser ou d’accepter que «les» ponts sautent ?
D’accepter comme une fatalité, la mort inattendue de Lucia, l’amoureuse qui ne supportait pourtant ni les injustices ni l’«apartheid» colonialiste ? Vivre le drame qui se déroule sous ses yeux sans s’engager, sans prendre position ? Saïd ira se recueillir devant la tombe de Lucie à Aix-en-Provence, mais aussi absurde soit-elle, la guerre est là. Il essaie d’affronter la situation, de répondre aux lancinantes questions qui le tourmentent. Que faire et comment être dans un pays colonisé ? Comment concilier le bien et le mal qui sont parfois les faces d’une même médaille ? Saïd finit par rejoindre son frère Bouzid au maquis mais sera tué par l’ennemi lors d’un autre accrochage militaire. La Dernière impression est l’illustration judicieuse de la période coloniale. Pour beaucoup, ce roman sobre est le plus abouti des quatre fictions de Malek Haddad. C’est aussi le roman du premier et du grand amour, écrit avec une simplicité que de nombreux auteurs n’atteignent qu’au bout de quatre ou cinq décennies. Simple et poétique, dans une langue légère, sans fioritures ni mots savants, ce livre pose des questions existentielles que se poseront d’autres auteurs, dont Albert Camus, notamment dans L’Étranger.
Le colonialisme comme toile de fond d’amours contrariés
Écrit en 1959, Je t’offrirai une gazelle est une histoire d’amour qui se déroule au Tassili, à l’ombre des palmiers du grand Erg oriental, entre Moulay le Chaâmbi et Yaminata, la femme Touareg à laquelle il a promis d’offrir une gazelle. Ainsi donc, Moulay –un chauffeur de camion dans une compagnie automobile transsaharienne – et son graisseur, Ali, partent à la chasse de la gazelle, au milieu du désert par temps de chaleurs.
Durant cette expédition, Ali meurt de soif avant que Moulay ne succombe à son tour sans pouvoir réaliser le vœu qu’il avait fait à Yaminata. Mais cette histoire est racontée par un écrivain, une histoire dans une histoire, un roman envoyé à un éditeur.
À Paris, Gisèle Duroc, la femme de l’éditeur en question, découvre le manuscrit. Elle noue très vite avec l’auteur une relation d’amour, également contrariée, non pas par le désert mais par la guerre, puisque l’histoire se situe durant la lutte de libération nationale. Ce roman, bâti sur deux histoires d’amour, ne veut pas donner une vision idéalisée, ni désabusée, non plus du pays. Les gens et la société vivent à leur rythme, les conditions politiques n’interdisant pas à la vie de se dérouler le plus naturellement du monde tout en créant les blocages factuels de l’histoire. L’Algérie n’est pas que le pays des gazelles, des mythes, des rêves et de l’exotisme puisque le conflit qui oppose le peuple au colonialisme est toujours en arrière-plan, déterminant, comme dans les autres fictions de l’auteur.
Publié en 1961, le troisième roman, Le Quai aux fleurs ne répond plus, est aussi une histoire d’amour contrariée. C’est dans cet endroit parisien que Khaled Ben Tobal vient retrouver régulièrement son ancien ami du lycée de Constantine, Simon Guedj. Khaled se laisse porter par l’amour de Monique, la femme de Simon, mais il ne pense qu’à sa femme Ourida laissée à Constantine. Puis il apprend qu’Ourida a une liaison avec un légionnaire, trahissant conjointement et lui-même et la patrie…
Ce roman est lui aussi marquée par la technique de la mise en abyme (où le récit s’insère dans le récit), et par une thématique où l’amour contrarié renvoie inéluctablement à un conflit armée qui dépasse les individus et les met devant des dilemmes cruels.
L’élève et la leçon relate une nuit de tête-à-tête entre un père, Idir Salah, et sa fille Fadila. Enceinte d’un compagnon qui est un combattant du FLN recherché par la police française, Fadhila demande à son géniteur, médecin à la soixantaine bien entamée, de la délivrer de la grossesse qu’elle porte. Plus que le dilemme du docteur, dont le serment est de donner la vie et non de tuer, et d’un père à qui sa fille demande l’avortement, L’élève et la leçon est une soirée de tourment pour l’homme qui est tiraillé entre sa fille, son devoir de médecin et la cause de la révolution.
Les quatre récits de fiction de Malek Haddad ont tous pour cadre temporel le contexte de la guerre de l’indépendance. Dans tous ces textes, l’amour est contrarié ou inachevé, les rêves toujours en suspens, et la mort plane souvent au-dessus de la vie, sans pour autant laisser dominer le désespoir. Tous ces écrits sont des débats intérieurs, des questionnements personnels mais liés à un cadre social et historique qui les dépasse.
Tout comme chez Mohamed Dib où Kateb Yacine, il n’y a pas chez Haddad de descriptions claires de la guerre mais les allusions se succèdent : un contrôle abusif de papiers d’identité, une famille décimée par le typhus, une enfant morte sous le sable… Quand Haddad lance une phrase, elle vaut son pesant de poudre : « Entre Paris et Alger, il n’y a pas deux mille kilomètres. Il y a quatre années de guerre. Il est inutile d’interroger.
Ce n’est pas du voyage, ce n’est pas du tourisme. Les trains ne s’en vont plus pour le plaisir de s’en aller. » (p. 98). Dans La dernière impression, Malek Haddad écrit : « Ah ! Ces visages tranquilles, ces visages vaguement sceptiques avec au coin des yeux une ironie gentille et résignée, ces visages bruns et éternellement juvéniles comme ces fruits prématurés tombés d’un arbre, un arbre qui décida de refleurir un jour de novembre. »
Le Poète et l’intellectuel déchiré par le problème linguistique
Certains critiques pensent que Malek Haddad romancier est plus consistant que le poète. Christiane Chaulet Achour note que « Le Malheur en danger édité en 1956 compte quelques trouvailles poétiques intéressantes mais c’est surtout le recueil de 1961, édité cette fois chez Maspero – éditeurs des Algériens en résistance –, Ecoute et je t’appelle, précédé de l’essai Les Zéros tournent en rond, qui marque à la fois la maturité créatrice de Malek Haddad et sa position idéologique dans « la culture nationale » qui s’annonce. ». Cependant, le premier recueil est émaillé de quelques beaux vers : « Il pleut sur ma patrie, la mort et la légende /Il suffit d’un épi pour que chantent les blés/Il suffit d’un moment pour que la nuit descende/ Et aussi d’un moment pour que le jour soit né ». C’est incontestablement le second recueil, Ecoute et je t’appelle, qui est plus consistant. Au thème de la lutte et de l’exil se juxtaposent celui de l’amour, de la mère-patrie et de l’enfance.
L’alexandrin pour les textes solennels voués au pays côtoie les poèmes libres. Ces textes ne sont parfois pas sans rappeler les poèmes écrits durant la Seconde guerre mondiale par Aragon : « Chez nous le mot Patrie a un goût de légende /Ma main a caressé le cœur des oliviers /Le manche de la hache est début d’épopée /Et j’ai vu mon grand-père au nom du Mokrani /Poser son chapelet pour voir passer des aigles /Chez nous le mot Patrie a un goût de colère » « Et la Paix revenue La Colombe dira /Qu’on me fiche la paix Je redeviens oiseau ».
La musicalité et le rythme prosodique de la poésie sont indéniables mais ils n’ont pas eu le temps de mûrir, car l’auteur a arrêté prématurément l’écriture. Trois poèmes de Malek Haddad sont publiés dans la première anthologie de la poésie algérienne, Poèmes algériens – Espoir et parole, de Denise Barrat qui présente 27 poètes et qui paraît en 1963 chez Seghers. « Ils vont dans la légende/ Et la légende ouvre ses bras/ Je leur avais parlé /J’avais senti leur main/ Ils avaient des enfants et même des défauts /Comme ils savaient sourire alors qu’il faisait nuit /Je les retrouve en achetant /Un journal /Ils étaient mes amis ils n’étaient pas des mots /Des chiffres ou des noms/ Ils étaient mille jours et dix ans de moi-même /Le repas qu’on partage/ La cigarette de l’ennui /Ils savaient mes enfants /Je leur donnais tous mes poèmes /Ma mère aimait leur cœur/ Ils étaient mes copains /Je leur avais parlé/ Ils vont dans la légende /Et la légende ouvre ses bras /Et ils sont devenus une âme et ma patrie/ Je ne verrai jamais mon copain le mineur /Son sourire éclairait son regard d’amertume /Mon copain le boucher et l’autre instituteur /Et je m’excuse /D’être vivant/ Je suis plus orphelin qu’une nuit sans lune /Ils vont dans la légende /Et la légende ouvre ses bras… »
Un livre est consacré à sa poésie de Malek Haddad. Cet ouvrage, publié chez Sédia, réunit des écrivains et des universitaires : Tahar Bekri, Jamel Eddine Bencheikh, Christiane Chaulet-Achour, Abdelkader Djemaï, Delphine Durand, Hubert Haddad, Safia Haddad, Abdecelem Ikhlef, Abdelmadjid Kaouah, Amira Gehanne Khalfallah, Jacqueline Levi-Valensi, Mohamed Kacimi, Tayeb Ould Laroussi, Isabelle Pinçon. La position de Malek Haddad a probablement occulté l’auteur. Mais il y a aussi son conflit, incompréhensible d’ailleurs, avec Jean Sénac, le premier auteur à faire un texte élogieux sur Nedjma et les textes de Kateb Yacine. En effet, en 1965 dans un débat sur la littérature maghrébine d’expression française, Malek Haddad déclare : « Je ne fais pas le procès de la langue française, la seule que je possède; je ne fais pas l’apologie de la langue arabe que je ne possède pas. Aucune langue au monde n’est supérieure à une autre langue. [… ] Je ne puis offrir (à mes lecteurs) qu’un approchant de ma pensée réelle et de leur propre pensée. Permettez-moi de me citer une fois de plus : « La langue française est mon exil », mais aujourd’hui, j’ajoute : la langue française est aussi l’exil de mes lecteurs. » Cette sentence est-elle justifiée ? Peu importe si l’auteur se trompe puisqu’avoir deux langues ou plus ce n’est pas s’appauvrir mais s’enrichir, et la monde en ces temps de mondialisation prouve que les outils linguistiques participent de l’enculturation et non pas de l’acculturation ou la déculturation.
Se sentant coupable d’une entreprise de déculturation, il arrête donc d’écrire. Il dit : « Le silence n’est pas un suicide, un hara-kiri. Je crois aux positions extrêmes. J’ai décidé de me taire; je n’éprouve aucun regret ni aucune amertume à poser mon stylo. On ne décolonise pas avec des mots. Je demeure convaincu que l’Algérie aura un jour les écrivains qu’elle mérite, qu’elle attend et qu’elle fera. […] On peut résister à Massu, à Bugeaud, à n’importe quel colonialiste, mais pas à Molière. […] Chez nous, c’est vrai, chaque fois qu’on a fait un bachelier, on a fait un Français. » La sensibilité de Malek Haddad l’a amené à un tel déchirement psycholinguistique que n’ont pas vécu les autres auteurs et intellectuels algériens. Kateb Yacine, Mohamed Dib, Mouloud Mammeri, Nouredine Aba ou Mustpaha Lacheraf continueront à écrire dans la langue de Molière qu’ils n’ont jamais assimilée à un vecteur de colonisation.
« Je parlais de coloniser dans l’âme. […] Je dis que nous ne sommes pas représentatifs du tout, nous écrivains d’expression française, et je le répète et je le maintiens plus que jamais, nous représentons un moment pathologique de l’histoire qu’on appelle le colonialisme. » Pour Kateb Yacine «la langue française est un butin de guerre», revendiquée comme un outil indispensable. Cependant, en dépit de sa position, Malek Haddad ne ses s’est jamais élevé contre la langue française elle-même. «Je serais mal placé, moi qui suis de formation intellectuelle française, pour condamner cette langue qui pour m’être étrangère n’en demeure pas moins mon seul outil et ma seule arme de combat », déclarait-il en mai 1961 à Damas dans une conférence.
Malek Haddad décède à Alger, le 2 juin 1978, des suites d’un cancer. «Il aura toujours connu une Algérie malheureuse : les soulèvements de 1945, la répression, la longue guerre puis, moins douloureuse parce que tellement attendue, cette genèse chaotique que fut l’Indépendance», écrit Safia, sa fille.
Par A.E.-H.T.