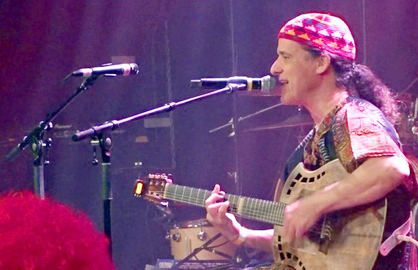Cinquante ans après, un film révèle que le King avait proposé au président d’infiltrer le mouvement hippie et les Black panthers.
«Monsieur le Président, permettez que je me présente. Mon nom est Elvis Presley… » Dans le Boeing 747 d’American Airlines qui fait la liaison entre Los Angeles et Washington, le passager ne parvient pas à trouver le sommeil. Il écrit avec application, au stylo bleu, sur le papier à en-tête de la compagnie d’aviation. Il réfléchit, rature parfois, met des majuscules là où elles ne s’imposent pas. Les pleins et les déliés, tracés fiévreusement, ne sont pas toujours lisibles. Elvis demande un café allongé à l’hôtesse, elle est aux petits soins pour lui. Il relit sa missive de cinq pages.
Si le style laisse à désirer, le fond de cette lettre écrite dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 décembre 1970 et destinée à Richard Nixon est proprement hallucinant. Son bras droit, Jerry Schilling, prend connaissance de la lettre avant l’atterrissage, n’ose rien modifier, n’en revient pas. Elvis, le rebelle des années 1950, y fait part de son inquiétude, fustige les hippies, les rouges, la contre-culture. Il précise que les leaders de ce courant gauchiste, Black Panthers, artistes pop, ne le considèrent pas comme un ennemi, qu’il peut facilement les infiltrer. Il explique être un expert en produits illicites : « J’ai étudié en profondeur les ramifications des réseaux de drogue et les techniques de lavage de cerveau des communistes. J’occupe une position au centre de tout cela qui me permettrait d’obtenir de nombreuses informations. »
Bref, il veut sauver le monde libre et, surtout, il souhaite devenir un « federal agent at large » (agent fédéral autonome) au Bureau des narcotiques et des drogues dangereuses. Schilling hallucine. Il connaît la passion de son ami et patron pour les flingues et les badges des services de police de différents Etats américains. Mais Elvis au FBI ! A la suite du cinquième feuillet, Presley a inscrit une dizaine de numéros de téléphone pour le joindre. Ceux de Graceland, des villas de Beverly Hills et de Palm Springs, et les trois numéros personnels du colonel Parker, son manager. Il y a ajouté celui de l’hôtel Washington où il séjournera « autant qu’il le faudra » sous le nom de Jon Burrows, suites 505, 506 et 507. Quand ils sortent de l’avion, Schilling est encore dubitatif : « On va où ? » Le petit sourire en coin qu’il aperçoit pourrait lui servir de réponse. « A la Maison-Blanche, bien sûr ! »
Elvis, le rebelle des années 1950, fustige les hippies, les rouges, la contre-culture
« Elvis & Nixon » est le titre d’un film distribué par les studios Warner qui sortira en France le 20 juillet. Une fiction décapante, drôle et dingue, mais également historique puisqu’elle est inspirée de faits aussi réels que surréalistes.
Lundi 21 décembre 1970, à 7 heures du matin, dans la voiture qui file vers Pennsylvania Avenue, Elvis se souvient de s’être fait remonter les bretelles la veille par Priscilla et Vernon. Sa femme et son père l’accablent sans cesse de reproches. Trop d’argent jeté par les fenêtres. Pour la dernière fête organisée à Graceland, il a acheté dix Mercedes et une trentaine d’armes à feu pour ses invités. Elvis a 35 ans et il s’en fout. Il a mis fin à sa carrière hollywoodienne l’année précédente, il s’y est beaucoup égaré. Il a entamé son come-back par un grand show télévisé, sorti un album, « From Elvis in Memphis », qui est resté en tête des ventes durant vingt semaines, et débuté une longue série de shows à l’International Hotel de Las Vegas. C’est un homme riche et célébrissime qui se présente à l’improviste devant l’aile nord-ouest de la Maison-Blanche. Cheveux longs, bagues et colliers en or, grande cape de velours jetée sur l’épaule. Dracula ? Non, the King. La lettre qu’il dépose lui-même pour « the Boss », comme il appelle Nixon, devrait logiquement finir dans une corbeille à papiers. Contre toute attente, elle va atteindre son but en quelques heures. L’effet Presley.
Dwight Chapin, secrétaire chargé du planning et des déplacements de Nixon, et le conseiller Egil Krogh, fan absolu d’Elvis, s’emparent immédiatement de l’affaire. A 10 heures, un mémo accompagné de la lettre est déposé sur le bureau du chef de cabinet, Bob Haldeman. Il lit, inscrit quelques mots au stylo plume : « C’est une blague, non ? » Puis il finit par se laisser convaincre. L’argument : Presley, bien utilisé, peut servir le président dans la grande campagne antidrogue qu’il vient de lancer. Il trace un A sur le mémo : approuvé. Chapin et Krogh filent dans le bureau Ovale, proposent à Nixon de recevoir Elvis vers 12 h 30, durant la pause qu’il met normalement à profit pour une courte sieste. Première réaction furieuse du Boss : « Quel est le con qui a organisé ça ? » Le refus est catégorique. Que se passe-t-il ensuite ? La thèse du film est délirante. Julie Nixon, fille cadette du président, est mise au courant de la demande d’Elvis. Elle veut une photo dédicacée et appelle son père. Délire, vraiment ?
Kevin Spacey, qui incarne Nixon dans le film, résume la situation : « Une histoire à hurler de rire ! »
Jerry Schilling, d’un côté, Egil Krogh, de l’autre, ont été les conseillers techniques du film. Leur doit-on cette version officieuse ? Officiellement, c’est le pouvoir de persuasion des hommes de l’ombre qui a, semble-t-il, payé. Elvis Presley ne vient-il pas d’être de nouveau élu parmi les dix personnalités les plus influentes du pays ? Nixon ronchonne mais cède. Accorde cinq minutes, pas une de plus. Kevin Spacey, qui l’incarne dans le film, résume la situation : « Une histoire à hurler de rire ! » Le film montre l’arrivée d’Elvis dans l’aile ouest de la Maison-Blanche, accompagné de Schilling et de Sonny West, l’un des hommes à tout faire de la « Memphis Mafia ». Une secrétaire les précède : « Monsieur Presley, c’est beau la Maison-Blanche, non ? » Il répond : « Ouais, ça ressemble à chez moi. » Il a apporté sa collection de badges officiels, des photos de sa famille et un cadeau qui ne passe pas le portique des services secrets : un colt 45 de la Seconde Guerre mondiale et des balles en argent dans un coffret de bois précieux. Tout dans la démesure. The King et the Boss, vingt-deux ans d’écart, un monde. La rencontre de deux ego surdimensionnés que tout oppose va pourtant avoir lieu. Krogh se souvient : « J’en avais les mains glacées. »
The Boss n’est pas du genre cool, pas du style à fréquenter les célébrités, à aimer la publicité. A mi-chemin de son premier mandat, Richard Nixon le conservateur se pose en modèle de stabilité, rempart à la poussée de la contre-culture, aux émeutes et aux manifestations qui prônent la désobéissance civile, la liberté de se droguer, d’afficher sa sexualité et s’opposent à la guerre au Vietnam. Trois cents morts américains par semaine à cette époque. Nixon est un homme austère, dur, discret, complexé. Jamais décontracté. Même quand il est seul chez lui, il porte une veste et une cravate. Aucun de ses amis ne l’appelle par son prénom. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a rien de rock’n’roll. Le télescopage entre les deux personnages frise l’absurde. Et pourtant.
L’entrevue démarre par une séance photo mémorable. Les clichés de Nixon et Elvis, archivés par la Maison-Blanche, sont aujourd’hui encore les plus consultés. Et puis, plus rien. Aucun témoin, aucun enregistrement. L’entretien qui devait durer cinq minutes s’éternise. Le film s’engouffre dans cet espace laissé vide : les deux hommes grignotent des M&M’s, boivent du Coca. Ils évoquent Woodstock, le grand concert hippie de 1969. « Juste une occasion de se foutre à poil », dit Elvis. Il fustige les journalistes, les Beatles, dénonce l’antiaméricanisme de John Lennon, qu’il a pourtant reçu chez lui. Le courant passe. Nixon et Presley ont les mêmes racines, l’un est fils d’épicier, l’autre de métayer. « Tous les deux, nous sommes partis de rien. »
Surtout, ils sont des patriotes. Nixon a servi dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale. L’incorporation dans l’armée d’Elvis, le 24 mars 1958, pour deux ans de service militaire en Allemagne, a été très médiatisée, tout autant que ses déclarations : « L’armée peut faire ce qu’elle veut de moi. » Entre le commandant en second et le sergent, il y a en commun une terreur absolue d’une forme de déliquescence de la société américaine. Face à l’insistance de son interlocuteur, Nixon promet. Elvis obtiendra finalement son badge. J. Edgar Hoover, patron du FBI, est-il au courant ? Il dispose d’un rapport de 683 pages sur Presley. Son comportement sur scène, qualifié de « strip-tease sans enlever ses vêtements », ses déhanchements très suggestifs (d’où le surnom de « Elvis the Pelvis »), l’hystérie qu’il déclenche auprès des jeunes gens des deux sexes, tout y est dénoncé. Certains rapports le qualifient même de « danger pour la sécurité des Etats-Unis ». Les addictions du King pour les armes à feu et pour nombre de médicaments sont un secret de Polichinelle. Personne n’en tient compte. Les mauvaises langues vont murmurer que Presley a besoin du badge FBI pour circuler tranquillement avec ses armes et ses produits médicamenteux, qu’il s’en sert parfois pour arrêter des chauffards pris en excès de vitesse. Des faits d’armes commis au nom du FBI…
Quatre ans plus tard, tandis que la santé d’Elvis Presley se détériore, le couperet tombe dans l’affaire du Watergate. Inculpation de Chapin, Krogh et Haldeman, démission de Richard Nixon. The Boss et the King. Deux chutes vertigineuses. Mais si le premier est devenu l’homme le plus haï d’Amérique, on idolâtre toujours Elvis Presley, inventeur du rock’n’roll et agent fédéral autonome.