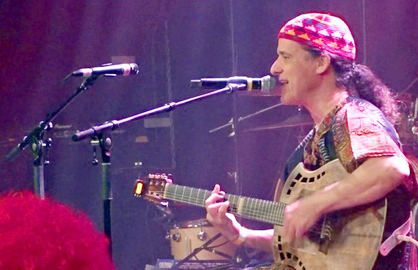À 61 ans, il n’a pas de scandales ou de franchises à son nom, pas de compte Instagram ou de vie publique. Ce qu’il a, c’est lui-même : un acteur hyper charismatique qui est sa propre franchise, une star des années 90 qui continue à faire des films des années 90 dans une industrie plongée dans l’enfance et le virtuel. Comment ? Pourquoi ? Tentatives de réponses.
Solide. Enraciné. Les pieds sur terre. Les Américains ont un mot qui les réunit tous : « Grounded ». Voilà. Denzel Washington est grounded. Quand il s’avance pour la première fois dans le cadre, vous savez qu’il est là. Pour de bon. Qu’il ne va pas s’envoler. Généralement, il sort d’une voiture et chaloupe du popotin en direction d’une scène de crime. Sa manière de cligner de l’œil avant de tourner la tête, ses long bras jetés en avant, sa démarche de grand félin, jambes croisées… Fermez les yeux, vous y êtes. Peu importe ce qu’il vient faire sur cette scène de crime, vous pouvez être sûrs que ce sera plié en moins de deux. Il n’y pas plus qualifié pour le job. Presque trop, à en juger par le petit air de lassitude. Denzel joue des professionnels qui ont « dépassé » leur job, revenus d’à peu près tout. Pas seulement à la retraite, médaillés ou corrompus, mais presque toujours alcooliques, alcooliques en puissance ou alcooliques repentis. Des professions essentiellement working class : flic, employé de Leroy Merlin, coach de lycée, avocat à la petite semaine, conducteur de train etc. Denzel vient à nous en simple représentant de l’humanité, en Mr-tout-le-monde pas tout à fait comme tout le monde. Dans une pièce remplie d’autres acteurs, comme dans son 7 Mercenaires, il est celui qu’on reconnaît comme notre point de référence et d’entrée dans l’histoire. Qu’il prétende avoir été back-up singer pour Gladys Knight, qu’il dirige un sous-marin ou qu’il tire (superbement) sur son six-coups, on le croit instantanément. Et même quand son personnage pourrait nous donner des raisons de douter, on continue de le croire, jusqu’au bout. Parce que c’est Denzel… Qui d’autre pour survivre à un film (au demeurant super) comme Training Day ? Qui d’autre pour surmonter l’énorme contrainte de scénario qui consiste à garder Hoyt (Ethan Hawke) dans la voiture d’Alonzo (Denzel) malgré les horreurs auxquelles il assiste ? Devant le film, on ne se pose pas la question ; ce pauvre Hoyt n’avait pas le choix, évidemment. Il était obligé de rester dans la voiture. Revoyez-le, c’est très clair. Magie du cinéma ? Non. Magie de Denzel.
Plus près de toi Denzel
Dans le remake des Sept Mercenaires réalisé par son acolyte Antoine Fuqua, il joue un ancien soldat à la moustache remplie de poussière, un cow-boy aimable et souriant avec une lueur de gravité dans le regard. Ce même personnage d’anti-héros sympa mais secrètement rageur qui a fait de lui une valeur commerciale stable dans un monde Marvel infantilisé. Là encore, il arpente le décor d’un film d’action lambda comme s’il était dans une pièce d’Arthur Miller. Et là encore, il est bien le seul. Vingt à trente minutes de films sont nécessaires avant de réaliser ce qu’on est en train de voir : Denzel. Sur un Cheval. Et rien (ni personne) d’autre. Les charges héroïques sont filmées en anamorphique, les sous-intrigues s’amoncellent autour des six compagnons, mais l’esthétique de la star Washington reste le seul et unique principe de la mise en scène. Comment il franchit la porte du saloon en « passant à travers », sans ressentir le besoin d’en pousser les battants, la dignité qu’il met à couper du bois et à s’éponger la sueur du front avec les bandes de son chapeau, son regard habité de démons lorsqu’il scanne la vallée à dos de canasson… Les épaules larges, très, très grand, Denzel utilise sa morphologie avec cet appétit du geste et ce sens de l’incarnation qu’on aimait chez les acteurs des années 40. Plus personne ne bouge comme ça aujourd’hui. Il glisse à l’image avec la confiance tranquille d’un vieux matou à la Bogart et délivre ses répliques en bon disciple (avoué) de Cagney, comme un loup dévore sa proie. Gene Hackman (le Denzel blanc ?) est probablement l’acteur contemporain dont il se rapproche le plus en termes de force d’intimidation et de présence physique pure. Ils ont tous les deux ce génie du sourire carnassier, du regard fixe et granitique qui réduit le type en face à néant ; Tony Scott ne s’était pas gouré en organisant leur rencontre au sommet dans USS Alabama… Mais si Denzel a fait de son corps de boxeur son outil numéro 1, il sait aussi travailler « autour ». A 61 ans, sa physiologie ne lui permet plus de perdre et de regagner du poids à volonté, comme à la grande époque de Malcolm X et Philadelphia, et sa silhouette s’en ressent. Plutôt que de laisser ce petit détail gâcher la fête, il s’en sert. Récemment, il s’est fait une spécialité du film d’action « assis ». Dans L’attaque du métro 123, Unstoppable, et jusqu’à Flight, tout explose en gerbes autour de lui mais Denzel dirige les opérations le cul vissé sur une chaise. Assis. Grounded.
Seuls les anges ont Denzel
Enraciné, il l’est aussi dans le cinéma américain. Ses thèmes, sa violence, sa quête de complexité. Particulièrement le cinéma adulte et sentencieux des années 90. Comme ses collègues stars de l’époque, de Tom Hanks à Mel Gibson en passant par Kevin Costner, Denzel a très vite cherché à fuir les personnages uniformément positifs pour embrasser sa face sombre et « tenter le diable », au sens le plus littéral du terme. Comme eux, il est passé à la mise en scène (Antwone Fisher, The Debatters et bientôt Fences, trois films sur la question raciale), avec moins de résultats, mais aussi moins de prétentions. Là où ses camarades de promotion se sont acclimatés à l’époque, perdant de leur exclusivité marchande en faveur de Twilight, lui a gagné le droit de rester une star bankable et, plus important, de rester une star des 90’s. Y’a-t-il plus anachronique qu’un film de Denzel Washington dans le paysage du cinéma commercial US ? A bien y regarder, tous ses films récents appartiennent au passé. Man On Fire ? Bodyguard sous cocaïne. Inside Man ? Une detective story à la Bogie. Flight ? Un mélo paranoïaque des années 50. Le nouveau 7 Mercenaires ? Un facsimilé de Silverado qui se fait passer pour le remake d’un classique de 1960… Seuls quatre films dans la carrière de Denzel ont dépassé la barre des 100 M $ au box office US, mais aucun n’est descendu en dessous des 50, le public conquis de la « Bible Belt » lui assurant un retour minimum garanti. C’est ici, dans le Sud protestant des Etats-Unis, que réside la vraie raison de sa longévité. Ici que sont ses vraies racines, et que pullulent ses fidèles, au premier rang desquels les femmes noires. Et que détestent les afro-américaines par-dessus tout ? Que leur lover préféré s’acoquine avec des blanches. Très conscient de son cœur de cible, Denzel a évité toute sa carrière de flirter d’un peu trop près avec Julia Roberts et Angelina Jolie, Eva Mendes lui servant régulièrement d’alibi ethnique. Ce n’est qu’en 2013, avec Flight, qu’il ferma les yeux et se décida à embrasser Kelly Reilly sur la bouche (et encore, du bout des lèvres)…
Le sens du religieux est indissociable de ses films. Fils de pasteur au passé trouble, ex-délinquant, ex-alcoolique, Denzel n’hésite jamais à prêcher le Mal pour le Bien, à souffrir en martyr (ou en Judas) pour la cause. Pour le meilleur et pour le pire, sans qu’on le voie réellement venir, il est devenu Charles Bronson, tendance évangéliste. Une main sur le flingue, l’autre sur la bible. Il vous tuera, oui, mais pas avant d’avoir récité un Jésus-Marie. Et donc il enfonce des clous dans des mafieux russes et envoie les kidnappeurs mexicains au cimetière avec leur rosaire.
Dans Les sept Mercenaires, il administre les derniers sacrements au vilain avant de lui faire sauter le caisson, là où Bronson himself, dans l’original, babysittait les enfants. Tout ça est à la fois trop sérieux, et pas assez. On pourrait penser qu’il se gâche un peu dans ces rôles d’empaleur biblique. Mais peut-on faire plus enraciné ?