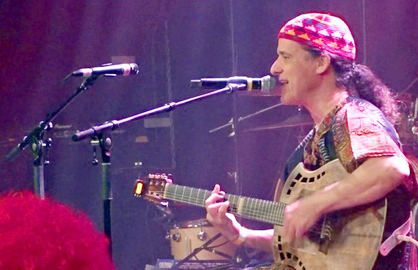Le réalisateur mexicain raconte ici comment il a décidé d’affronter un tournage aux conditions extrêmes…
«Il est dans la meilleure période de sa vie », dit Alejandro Gonzalez Inarritu de Di Caprio, en vantant la passion de son acteur, sa détermination, la liberté souveraine avec laquelle celui-ci mène sa carrière. Il parle de Leonardo, mais il pourrait tout aussi bien être en train de parler de lui. Le surdoué d’Amours chiennes, le poète world de Babel, l’abonné cannois, l’homme qui composait des mosaïques globalisées dans les années 2000, est devenu sans qu’on s’en rende compte le nouveau chouchou de l’Académie des Oscars. L’incarnation absolue du super-auteur contemporain. Fidèle à ses obsessions mais désireux de muter, de changer de style au gré de ses rencontres artistiques (le scénariste Guillermo Arriaga hier, le chef op’ Emmanuel Lubezki aujourd’hui). Capable de transformer une déambulation en plan-séquence dans un théâtre de Broadway avec une star has-been en triomphe arty (Birdman) ou de partir dans le Grand Nord ressusciter les fantômes d’un cinéma trippant et viscéral. Inarritu est en pleine possession de ses moyens, « dans la meilleure période de sa vie », oui, comme le prouve la sérénité avec laquelle il a organisé le chaos de The Revenant.
Il y a dans The Revenant une image qui glace le sang. Celle de ce trappeur pendu par des Indiens, avec une pancarte autour du cou sur laquelle on peut lire, en français : « On est tous des sauvages. » Dans le contexte de l’après-Charlie, de l’après 13 novembre, ça provoque une vraie sidération…
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Cette image ne sort pas de mon imagination : pendant mes recherches, je suis tombé sur une photo avec cet homme pendu, cette pancarte… C’était vraiment choquant. Très tôt, en commençant à travailler sur cette histoire, j’ai été fasciné par les résonnances contemporaines qu’elle pouvait avoir. Aux Etats-Unis, au milieu du XIXème siècle, il y avait des Français, des Canadiens, des Espagnols, des Mexicains… C’était vraiment une société multiculturelle. Je n’avais jamais envisagé cette époque comme ça. Avant, quand je pensais aux Indiens, j’associais ça aux cowboys, aux saloons…
The Revenant appartient à cette tradition de cinéma, très vivace dans les 70’s, qui veut que pour tourner un grand film, il faut savoir se mettre en danger. Partir à l’autre bout du monde, jouer gros, risquer de tout perdre, et revenir avec un chef-d’œuvre si on a la chance d’en sortir vivant. Coppola avec Apocalypse Now, Herzog avec Aguirre, la colère de Dieu, Friedkin avec Sorcerer… Vous vous inscrivez complètement dans cette mystique-là.
Mais cette tradition remonte bien plus loin que les 70’s : c’est l’essence même du cinéma ! Empoigner une caméra, partir à l’aventure pour ramener des images du monde, c’était le b.a.-ba du cinéma à l’origine. C’est ce que je voulais retrouver avec ce film : la vérité des choses, l’essence du médium. Parce que la réalité est plus grande et plus belle que tout ce que les plateaux de tournage ou les fonds bleus peuvent nous offrir.
Mais est-ce que ça implique qu’il faut nécessairement souffrir pour faire des grands films ?
Je ne sais pas… Je crois que ça dépend de votre tempérament d’artiste.
Parlons du vôtre…
Mon sentiment, c’est qu’on est trop gâtés. On se plaint dès qu’on a un rhume, ou parce qu’il n’y a n’a pas de wi-fi dans l’avion. C’est pathétique. On est devenus incapables de vivre comme les créatures que nous sommes. Alors, oui, le tournage de The Revenant, c’était beaucoup de problèmes, très peu de confort. Je savais dans quoi je m’aventurais. Je savais que ça allait être très dur. Toute l’équipe était au diapason, c’était le deal, il n’était pas question de passer une journée tranquille au bureau. Ceci dit, il y a un gouffre entre le savoir et l’expérience… La réalité a été beaucoup plus dure que ce que j’imaginais. J’étais préparé mentalement, pourtant je n’arrive plus à compter les fois où je me suis dit : « Putain ! Qu’est-ce que tu fous là ? Dans quoi tu t’es embarqué? » Mais c’était l’idée, justement. C’est le sujet du film. L’histoire d’un homme qui affronte la nature. La nature le blesse, puis le soigne, le protège et tente de le tuer en même temps. En faisant ce film, on vivait la même chose que les personnages. Leur odyssée est devenue la nôtre. Il y a le method acting. Disons que ça, c’est du method directing !
C’est exactement ce que Coppola disait à propos d’Apocalypse Now : « On est partis dans la jungle faire un film sur le Vietnam, et, petit à petit, ce tournage est devenu notre Vietnam. »
Ah ah ah ! Voilà ! C’est ça ! Nous, c’était comme si on se faisait attaquer par un ours quotidiennement. C’est un truc qu’on se disait souvent avec Chivo (surnom du chef opérateur Emmanuel Lubezki) : « Cet ours veut se servir de nos couilles comme en-cas. Qu’est-ce qu’il a contre les couilles mexicaines ? » Hé, hé, hé ! La nature a toujours le dernier mot. Mais si vous en sortez indemne, alors c’est merveilleux. Un ravissement. Les gens n’en revenaient pas quand ils voyaient les images qu’on rapportait. Pourtant, tout est là, à portée de main. Il suffit de saisir ces beautés de la bonne manière, au bon moment de la journée.
Vous êtes devenu un réalisateur différent depuis Birdman et votre association avec Lubezki. Cette réinvention, c’était un choix conscient ou ça s’est fait par hasard ? Vous aviez envie d’explorer de nouveaux territoires, ou c’est Chivo qui vous a pris par la main ?
C’est difficile de savoir d’où viennent ces choses. Et c’est bien que tout ce processus reste un peu mystérieux. Je précise d’abord que je n’ai pas rencontré Chivo comme ça, bim, du jour au lendemain. Je le connais depuis 25 ans, on a fait un court-métrage ensemble pour le Festival de Cannes, on bossait sur des pubs quand on était plus jeunes. On a toujours été très proches, lui, Alfonso (Cuaron, réalisateur de Gravity, qui a valu un Oscar à Lubeszki) et moi. Il s’est naturellement imposé comme le partenaire idéal pour Birdman. Et c’est vrai que ce film m’a libéré. Artistiquement, je ne vois pourtant pas ça comme une rupture, plutôt comme une transition naturelle, comme quand l’automne succède à l’été.
Ces deux films, ces deux odyssées mentales, Birdman et The Revenant, vous les envisagez comme les deux faces d’une même pièce ?
Sur le plan de la grammaire visuelle, oui. Mais sur le plan de l’expérience elle-même, c’est le jour et la nuit. J’ai tourné tout Birdman dans un décor unique, superbe, un café chaud à portée de main. Le moindre détail de chaque plan était contrôlé. J’étais Dieu. Sur The Revenant, je suis redevenu une créature! Ce film, c’est l’étape d’après. Le plus complexe que j’ai jamais fait. Comme je vous le disais : un hommage au cinéma pur. Avec le moins de dialogues possibles, et cette idée que c’est l’action qui guide le récit. Une grande aventure dans la lignée de London et de Conrad, mais racontée avec des moyens cinématographiques.
Quand vous bossez avec Lubezki, le chef op du Nouveau Monde et de The Tree of Life, c’est aussi un moyen d’engager le dialogue avec Terrence Malick ?
Mais The Revenant est tellement différent de Malick ! Chez lui, maintenant, tout est fragmenté, très découpé, avec cette voix off qui fait le lien entre les images. Ça tient plus de l’essai, de l’expression d’une pensée rendue sous forme de tourbillon. Honnêtement, quand on dit que mon film est « malickien », tout ça parce que Chivo en a fait la photo, ça me fait rigoler. Rien à voir.
Quand même : cette caméra qui « flotte » comme en apesanteur, l’utilisation du grand angle, l’obsession pour la nature et l’au-delà…
Non, non, non. Regardez bien les derniers Malick : il n’y a pas un plan qui dure plus de cinq secondes. On ne recherche pas du tout la même chose, lui et moi. Tant mieux. Le cinéma, c’est un océan. Malick va par ici, moi par là (il tend ses deux bras dans des directions opposées). On est porté par des courants différents. On est sur la même mer. La mer du cinéma. Mais on n’affronte pas les mêmes vagues.
Le plan-clé de The Revenant, celui qui synthétise toute votre démarche, c’est ce moment où le souffle de DiCaprio vient embuer l’écran. Vous l’aviez en tête longtemps avant le tournage ?
Non, c’est arrivé par hasard. Un heureux accident. Il faisait tellement froid… Quand j’ai vu ça, j’ai encouragé Chivo à se rapprocher. C’est risqué parce qu’à ce moment-là, on brise clairement le quatrième mur, on fait un clin d’œil au public en lui rappelant qu’il est au cinéma. Mais j’adore ça, parce que soudain, ça renvoie le spectateur à sa propre existence. Il prend conscience qu’il est train de respirer. Et ce besoin irrépressible de respirer, de se battre jusqu’à son dernier souffle, c’est ce qui nous relie tous les uns aux autres – à part les terroristes, malheureusement.
Qu’est-ce que vous pouvez faire après ce doublé-là ? C’est quoi, l’étape d’après ?
Oh oh, aucune idée ! Je suis épuisé, j’ai l’impression que je viens de courir deux marathons d’affilée. Birdman était encore en mixage quand j’ai commencé la pré-production de The Revenant. Je n’avais jamais fait ça.
D’habitude, il s’écoule trois ans entre chacun des mes projets. Je ne suis pas un « filmeur », je ne tourne pas sur commande. J’ai envie de vivre, pas de faire carrière à Hollywood. Donc, là, ce dont j’ai besoin, c’est de rentrer chez moi, de méditer, de marcher dans la forêt, de me ressourcer. De passer un peu de temps avec moi-même.
Comment ça se fait, au fait, que vous ayez tourné ces deux films coup sur coup ?
The Revenant est un vieux projet. J’ai commencé les repérages il y a déjà cinq ans. Puis Leonardo a soudain eu le feu vert pour Le Loup de Wall Street, qu’il se battait pour financer depuis des années. J’ai tourné Birdman en attendant qu’il soit à nouveau disponible. Mais c’était très bien comme ça, parce que ça m’a permis d’aborder The Revenant un peu plus mature, un peu plus aguerri. Et, accessoirement, d’échapper à la tournée promo de Birdman !
De Birdman à The Revenant, on voit de plus en souvent des gens en train de flotter dans les airs dans vos films…
Le réalisme m’intéresse de moins en moins. Qu’est-ce que la réalité, sinon une interprétation ? La façon dont on rêve la vie, dont on s’en souvient, voilà ce dont je veux parler. On ne sait pas grand-chose de Hugh Glass, seulement quelques détails très concrets, très terre-à-terre, très « physiques ». Par conséquent, on peut accrocher ce qu’on veut sur son histoire. Moi, j’étais très heureux d’y insuffler cette dimension spirituelle. D’explorer l’idée du souvenir, du rêve, de la transcendance. De traquer les fantômes de perceptions inconscientes. Et pour exprimer ça sans mots, il n’y a rien de mieux que le cinéma.