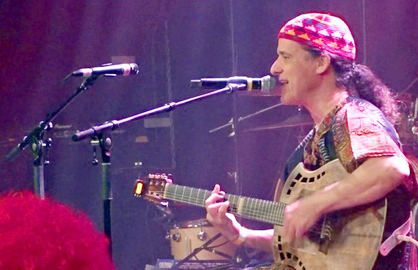Avec ce tout premier « stand-alone », le studio place ses pions industriels pour la décennie à venir. Star Wars, l’histoire sans fin ? Ça commence comme ça a toujours commencé. Onze petits mots bleus sur un écran noir, la formule magique la plus efficace au monde : « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… » Et puis, soudain, tout change. Au lieu du légendaire générique déroulant et de son triomphal orchestre made by John Williams, on bascule directement au cœur de l’action. Sans transition : c’est parti pour Rogue One, 2 h 13 d’aventure galactique échevelée !
La suppression du générique d’ouverture inventé par George Lucas n’est pas anodine. Elle illustre le statut particulier de ce film, qui est et n’est pas tout à fait un Star Wars. Contrairement au Réveil de la Force, Rogue One : A Star War Story ne porte pas de numéro de série. Il ne peut pas non plus compter sur Luke Skywalker pour attirer les fans – ses héros sont inconnus au bataillon. Pis, il n’y a pas trace de Jedi dans cet opus ! Rogue One est ce que son studio appelle un stand-alone (« qui tient tout seul »), un film décorrélé de l’intrigue principale et auquel on ne donnera pas de suite. C’est pourtant sur lui que repose l’avenir de la saga.
Usine
Lucasfilm teste ici pour la première fois le modèle d’exploitation arrêté au moment de son rachat par Disney et inspiré de celui des super-héros de Marvel : un long-métrage tous les ans jusqu’en 2019… au moins. Si le programme s’arrête officiellement en 2019, l’objectif est évidemment de continuer – la compagnie n’a pas dépensé 4 milliards de dollars pour s’abstenir après cinq volets. Rogue One est un cheval de Troie. La pierre angulaire du pari de Disney : faire de l’univers lucassien une usine du divertissement capable de produire des films jusqu’à… eh bien, la fin du monde, idéalement.
« Rogue One est un formidable point de départ parce qu’il contient des éléments familiers, des points d’ancrage, tout en introduisant un nouvel ensemble de personnages. C’est un très bon échantillon du genre de choses que ces films pourront faire », expliquait récemment la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Situé après La Revanche des Sith et avant Un nouvel espoir, cet « épisode » raconte effectivement un événement connu des fans parce qu’évoqué dans le texte d’ouverture du tout premier Star Wars : le vol des plans de l’Étoile noire par des espions de l’Alliance rebelle. Puisqu’on connaît déjà la fin, l’enjeu n’est pas scénaristique. La vraie mission du réalisateur, Gareth Edwards ? Trouver ce qui fait le cœur de Star Wars, ce qui pourra fonctionner même lorsque Dark Vador et sa famille auront définitivement disparu.
Ce n’est pas un hasard si Rogue One est sous-titré « A Star Wars Story »
Ce n’est pas un hasard si Rogue One est sous-titré « A Star Wars Story », « une histoire de Star Wars ». « Une » et non pas « L’ » histoire, celle des Skywalker, jusqu’ici essentielle à la saga. Pour espérer traverser les décennies et les générations, la franchise doit pouvoir passer outre ses héros originels et explorer des territoires vierges. En supprimant le traditionnel générique ou en ne faisant, par exemple, plus que lointainement appel aux thèmes musicaux de Williams (pour la première fois, le maestro ne signe pas la bande originale), le studio prend progressivement ses distances avec l’héritage de Lucas. C’est, au fond, la seule façon d’éviter l’épuisement du filon.
Impossible de ne pas s’interroger sur cet horizon industriel. Avec tous ces millions en jeu, difficile de croire que les réalisateurs des nouveaux Star Wars puissent être autre chose que des contremaîtres chargés du bon fonctionnement de la locomotive. Gareth Edwards l’admet d’ailleurs bien volontiers : son film aurait pu « quasiment se faire tout seul ». « Si on garde l’analogie de l’usine, je pense que le réalisateur a deux rôles principaux », nous confiait-il, très pragmatique, en septembre. « Se tenir à l’entrée et trier les ingrédients pour ne garder que les meilleurs ; et se tenir à la sortie pour se débarrasser de tout ce qui n’est pas bon ». Autrement dit, n’être qu’un filtre veillant à la conformité du produit final. Subsistera-t-il alors une vision de cinéaste dans ces films pressurés par les calculs marketing et les impératifs de résultats ?
Question à 4 milliards
« Un Star Wars n’est pas un film d’auteur qu’on fait juste pour soi, c’est un sport d’équipe », rétorque Edwards, beau joueur. « Si on fait bien son travail, c’est un film qui plaît au monde entier. » L’exploit est d’être parvenu à insuffler en plus à Rogue One une véritable identité, qui ravive l’espoir de la persistance d’une âme dans la machine. Miracle ou preuve par l’exemple du bien-fondé de la méthode ? L’avenir seul le dira. Tout dépend maintenant du box-office.
Plusieurs scénarios sont envisagés pour la suite, parmi lesquels le lancement de nouvelles trilogies ou l’idée de ne plus faire que des stand-alone pour aller toujours plus loin dans la galaxie. Reste la question à 4 milliards : combien de Star Wars font trop de Star Wars ? Le public finira bien par saturer, non ? « Je n’arrive pas à imaginer qu’on puisse s’en lasser », proteste Gareth Edwards. « C’est comme les cadeaux de Noël, est-ce qu’on se fatigue d’en recevoir tous les ans ?» Dit comme ça, forcément…