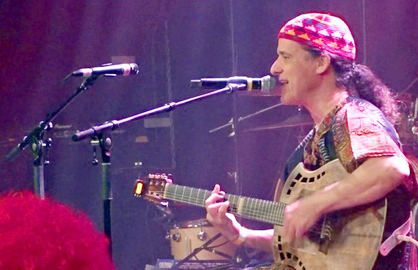Mohamed Dib s’est éteint vendredi 2 mai 2003, à l’âge de quatre-vingt-deux ans, en France où il a vécu depuis 1959, date de la parution aux Éditions du Seuil de La Grande Maison, premier volet de sa trilogie Algérie. Les deux autres volets de la trilogie, L’Incendie et Le Métier à tisser, paraissent en 1954, l’année même du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.
Par Ali El Hadj Tahar
Si dans les premiers livres l’auteur se contente de faire allusion aux injustices coloniales de manière indirecte, tout en insistant sur les valeurs et la culture nationales pour signifier que l’Algérie ne peut être définitivement spoliée, la Guerre d’Indépendance est abordée plus explicitement dans Un été africain. Le contenu de ce roman compte parmi les raisons qui pousseront la police coloniale à accuser Dib d’activités subversives et de l’expulser en France, en 1959. Sensible à la dimension humaine du socialisme et de son idéal social et anti- impérialiste, l’auteur entreprend plusieurs voyages dans les pays de l’Est, qui fournissaient alors une aide substantielle à la Révolution algérienne. Sa position anticolonialiste est bien affichée dans Qui se souvient de la mer, roman publié en 1962 et qui dresse un sombre tableau du colonialisme.
Dans les premières œuvres post-indépendance, notamment Cours sur la rive sauvage (1964), La danse du roi (1968), Dieu en Barbarie (1970), «Le maître de chasse» (1973), et des recueils de poèmes Formulaires (1970) et Omnéros (1975), l’écrivain amorce une nouvelle étape littéraire, et rompt avec le réalisme et la lisibilité pour un style plus abstrait. L’écriture est moins linéaire, de plus en plus poétique et philosophique. Dib explique ce changement de thématique et d’écriture par le fait que l’arrachement de l’Indépendance a rendu caduque le réalisme social qui caractérisait son œuvre, et ses sujets à caractère nationaliste. « Je dois ajouter, en ce qui me concerne, que tant que l’Algérie était une colonie, je pensais et je le pense toujours, qu’un écrivain doit accomplir un devoir envers son pays en affirmant sa personnalité, en posant la revendication de son pays et de son peuple », disait Dib en 1999. Il explique son ancienne thématique, disant : « Le devoir de nommer l’Algérie, de la montrer. Ce devoir équivalait à une sorte d’acte de foi, il suffisait de nommer les gens, de montrer comment ils sont physiquement, de montrer leurs comportements, la nature qui les entoure. Cela suffisait à l’époque de décrire un paysage algérien pour faire acte de foi et amener l’Algérie à l’existence littéraire […]. Mais à partir du moment où l’Algérie est devenue indépendante, j’ai pensé que l’écrivain étant indépendant lui-même, son devoir n’était plus de présenter son pays et ses revendications, mais de se livrer à une réflexion plus personnelle. Elle doit, de ce fait, porter sur les problèmes plus intérieurs de l’écrivain d’une part, et de la société d’autre part. »
l’Algérie cesse d’être le décor de l’œuvre, qui se déterritorialise vers d’autres espaces, que ce soit en France, en Finlande ou ailleurs. Le pays natal n’est parfois plus évoqué que par un nom, un lieu que la mémoire maintient dans ces croisements entre Orient et Occident que l’on retrouve dans une station de métro parisienne, dans une rue d’un pays du froid… Les fréquents séjours de Dib en Finlande, où il collabore, avec Guillevic, à des traductions d’écrivains finlandais, lui inspirent sa « trilogie nordique » publiée à partir de 1989 : Les Terrasses d’Orsol, Neiges de marbre, Le Sommeil d’Ève. Certains critiques ont perçu dans sa trilogie nordique une inspiration issue du patrimoine ésotérique Soufi, comme le fit le critique Bachir Adjil, (Espace et écriture chez Mohammed Dib, L’Harmattan, Paris 1995), l’un des nombreux auteurs à étudier l’œuvre de l’écrivain algérien, dont Naguet Khadda et Beïda Chikhi.
Au croisement des cultures et des êtres
L’œuvre postindépendance de Did devient celle de l’errance identitaire, de la quête de soi, de l’introspection, de la rêverie, des mixages et des croisements dans l’exil, à l’image de la petite fille Lily Belle (dans L’Infante maure) issue d’un couple mixte franco-mauritanien. La petite fille fait la jonction entre le Sahara et le pays du froid et de la neige, brassant différente couleurs et odeurs. Dans L’Infante maure, c’est un délire inscrit dans un rêve ou un cauchemar éveillé : celui de Lilly, tandis que dans les terrasses d’Orsol, Ed, le narrateur, malade et blessé par son divorce, quitte Orsol, sa ville natale et son poste d’enseignant à l’université pour une mission de longue durée à Jarbher comme envoyé en mission pour découvrir le mystère de cette ville, où il vivra le temps vide de l’ennui. Il se soumet à l’obligation de retourner sans cesse à la grotte pour interroger, sans résultat, les habitants mystérieux et envoyer des rapports sans espoir d’être lus, à un gouvernement lointain, aussi indifférent, lui aussi.
L’inquiétude règne dans cette littérature faite d’un « réseau luxuriant de paraboles et de correspondances », qui lient tous les romans les uns aux autres, comme on peut le lire dans La Nuit sauvage où Dib parle des « affinités secrètes entre tous les romans d’un même écrivain». La fiction se charge de poésie, et même les noms se chargent de mystère qui fait dériver l’œuvre d’une ambiance des Mille et une nuits à celle d’un conte ou d’une œuvre de science fiction. Ces moments et ces styles se relient aussi par les noms pleins de poésie et d’énigmes : Hellé, Lily, Aëlle, Lyyli-belle. L’enfant chez Dib, c’est peut-être la femme qui se rêve fille innocente, et l’innocente qui se rêve femme adulte l’une se projetant dans le passé et l’autre, dans le futur. Impatience et insatisfaction de l’humain, ce qui lui rend insupportable son temps et son présent. Mais le bonheur existe aussi dans l’œuvre de Dib.
Les clés des cultures se croisent entre Orient et Occident dans cette œuvre polysémique et plurielle. Les brassages des identités se mirent dans cette littérature-poésie-conte qui énonce et qui parfois évoque, éclaire et parfois brouille les pistes, sans qu’on sache si l’environnement est d’Orient ou d’Occident, s’il s’agit d’un pays du Nord ou d’un pays de soleil. Dans les nouvelles et les romans anciens comme dans les plus récents, ce sont les mêmes motifs qui se croisent, plus évocateurs que clarificateurs, où se combinent les symboles, les images, les paraboles. La vie, c’est l’enfant ou l’adulte, la femme ou l’homme, et même le sphinx, tout aussi énigmatique que les premiers, chacun portant ses mystères, ses secrets.
L’œuvre de Dib, qui s’étale sur une assez longue carrière, est assez prolifique, de même qu’elle a une indéniable dimension internationale, tout comme celle de Kateb Yacine et de Rachid Boudjedra, les auteurs algériens les plus universels. Mohammed Dib a publié près de 38 œuvres, dont 16 romans, 4 recueils de nouvelles, 7 recueils de poésie, 2 recueils de contes, une pièce de théâtre et 2 essais. Il a reçu de nombreux prix, notamment le prix Fénéon (1953) pour son premier roman La Grande maison, le prix René Laporte (1962) pour le recueil de poésie Ombre gardienne, le prix de l’Association des écrivains de langue française (1977) pour le roman Habel, et plusieurs prix de l’Académie française pour la poésie ou les romans. En 1994, il reçoit le Grand Prix de la Francophonie décerné par l’Académie française ; en 1998, le prix Mallarmé lui est décerné pour son recueil de poésie L’Enfant jazz, et le Grand Prix du Roman de la Ville de Paris pour l’ensemble de son œuvre romanesque. En 2001, le Prix des Découvreurs de la Ville de Boulogne/Mer récompense l’ensemble de son œuvre poétique.
Atypique dans la littérature universelle
On ne peut pas dire que Dib ait été très privilégié par les jurys français ou internationaux et il est clair que les intellectuels de son pays n’ont fait aucun lobbying pour qu’il soit plus honoré à l’échelle internationale. Il est probable aussi que Dib n’ait pas été avantagé en ce sens par le fait que, contrairement à beaucoup d’auteurs, il ait refusé de prendre la nationalité française et se soit toujours considéré comme un émigré en France et non pas comme un citoyen de ce pays. Préoccupée par son présent, l’Algérie, où il a obtenu le prix de l’Union des écrivains algériens en 1966, ne lui a pas suffisamment rendu hommage, il faut le reconnaître.
Dans les années quatre-vingt-dix, Dib forge un nouveau style d’expérimentation d’un genre qui tente de dépasser les genres établis ; que ce soit L’Arbre à dires (1998), Comme un bruit d’abeilles (2001), Simorgh (2003), ou Laëzza (posthume, 2006), Une écriture parallèle, mosaïque juxtapose différentes formes d’écriture : récit, nouvelle, essai, journal de bord, souvenirs, dans une tentative de dire une réalité fragmentée, parcellaire, et d’en recoller les morceaux disparates. Dib est un écrivain atypique, en ce sens que contrairement à tous les grands écrivains qui ont fait le choix d’approfondir l’ancrage national, de développer l’approfondissement identitaire, il a dilué l’identité, se revendiquant de l’universalité en essayant d’y plonger et non pas en remontant le cours de l’identité. Il s’est exploré dans l’Autre et dans la culture de l’Autre, alors que tous les écrivains de son envergure ont exploré les figures et les mystères de leur propre peuple. Dib, l’auteur cosmopolitique est donc atypique dans la littérature universelle et ne peut être comparé qu’à Paul Bowles qui a vécu une grande partie de sa vie au Maroc et qui a consacré une bonne partie de son œuvre à ce pays, même si sur le plan de l’écriture, l’écrivain américain et l’écrivain algérien sont aux antipodes l’un de l’autre.
Cette œuvre de grande envergure devait faire de Dib un récipiendaire du Nobel, mais il n’a même pas obtenu un Goncourt, ce qui ne fait que grandir cet auteur d’entre deux rives. Ce brasseur de cultures, ce polleniseur d’identités, ce trafiquants d’identités hybrides en quête de plus de paix et de bien-être humains, est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, dans une famille d’artisans ruinés. Ayant perdu son père à l’âge de onze ans, sa mère, une femme dure à la tâche et autoritaire, est l’archétype de Aïni, personnage central du premier roman, La Grande Maison. Aïni fournit en fait le modèle de plusieurs personnages féminins dans l’œuvre dibienne. Dib, qui a effectué ses études primaires et secondaires à Tlemcen, n’a eu qu’un bref passage à l’École normale supérieure d’Oran, avant de devenir instituteur à Zoudj-Beghal en 1939 et, entre autres, interprète anglais-français auprès des bureaux des armées alliées à Alger durant 1943-44. Recruté par Alger Républicain, à partir de 1950, il y publie des reportages sociaux, des chroniques littéraires et artistiques.
Il est difficile de résumer cette grande œuvre, alors laissons la parole à Dib qui parle de son écriture poésie-poème, pour ne pas parler de proème, un genre connu et dont il est aussi friand : « On se trouve face à un problème momentanément insoluble : l’exercice de la poésie mène vers un tel affinement, à une recherche tellement poussée dans l’expression, à une telle concentration dans l’image ou le mot qu’on aboutit à une impasse […]. Il faut briser le mur d’une façon ou d’une autre. Et voilà pourquoi je fais les deux choses à la fois. Le roman n’est-il pas, d’ailleurs, une sorte de poème inexprimé ? La poésie n’est-elle pas le noyau central du roman ? Et les anciens n’avaient-ils pas raison de baptiser leur œuvre en prose mon poème ? »
A. E. T.