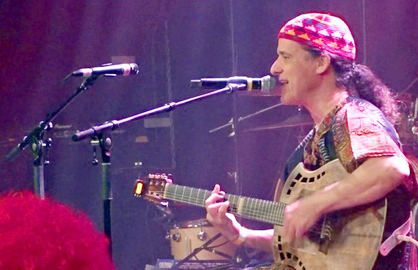L’émir Abdelkader naît près de la ville de Mascara en 1808, d’une famille de l’aristocratie religieuse originaire du Rif. Son père, Mahieddine al-Hassani, est un muqaddam dans une zaouia affiliée à la confrérie soufie Qadiriyya et revendique une descendance de Mohamed (QSSSL), par son lien avéré avec les Idrissides.
Ali El Hadj Tahar
Il grandit dans la zaouïa de son père qui, au début du 19e siècle, connait un certain rayonnement d’autant que liée à une communauté florissante sur les bords de la rivière de l’Oued el Hammam. Les zaouias, indépendante du pouvoir ottoman qui ne se souciait pas de l’éducation et se contentait de ramasser les impôts par la force, assurent alors l’éducation à des millions d’Algériens. Grâce aux petites écoles traditionnelles liées aux zaouias et dispensant une alphabétisation à base religieuse, probablement essentiellement aux arçons, près de 90% des Algériens sont alphabétisés, selon des écrits français de l’époque. L’émir Abdelkader aura la chance, avec quelques milliers d’autres compatriotes de recevoir un enseignement plus poussé, sans bénéficier comme en Europe des bienfaits de l’imprimerie. Comme tous les étudiants, il reçoit une éducation traditionnelle en théologie, jurisprudence et grammaire ; et l’on répète qu’il savait lire et écrire à l’âge de cinq ans. En tout cas, à l’âge de 14 ans, il récite le Coran par cœur, recevant ainsi le titre de hafiz. A15 ans, il est interne à Oran pour poursuivre ses études. Déjà bon orateur, il arrive à retenir ses condisciples avec poésies et diatribes religieuses. Plus tard, la colonisation française va essayer de briser ce système éducatif en le privant en grande partie de ses ressource, et ce choc que va pousser presque toutes les zaouias dans l’opposition.
En 1825, âgé de 18 ans, il accompagne son père en pèlerinage à La Mecque. Le voyage les amène plus tard à Damas et à Bagdad, où ils visitent les tombes d’Ibn Arabi et de Sidi Abdelkader al-Jilani, entre autres. En Égypte, ils auront le temps d’apprécier les réformes menées par Mohammed Ali, et de saisir le décalage par rapport à la misère due à la colonisation ottomane dans son pays. Quelques mois à peine après le retour de voyage, les Français débarquent à Sidi Fredj. Mahieddine a toujours été hostile à la colonisation turque, et sait qu’en réaction aux pressions européennes, certains chefs musulmans tentent de réformer leur État, notamment le pacha d’Égypte.
L’occupation française accentue le ressentiment refoulé contre les Ottomans, qui font partout l’objet de rébellions au début du 19e siècle mais non sans diviser le peuple. Sans chefs charismatiques, ces rebellions ne permettent ni de les battre ni de faire face efficacement à la nouvelle colonisation. Le dernier dey d’Alger, Hussein, envoie un émissaire demandant protection auprès de Mahieddine, ce à quoi Abdelkader dit à son père que s’il venait à la zaouia, il le tuerait de ses propres mains. Lorsque l’armée française arrive à Oran en janvier 1831, Mahieddine lance une campagne de harcèlement. Il appelle au jihad, et participe avec son fils aux premières attaques sous les murs de la ville. Dès novembre 1832, les tribus de la région de Mascara proclament Mahieddine comme sultan, charge à laquelle il renonce en faveur de son fils. À l’automne de 1832, lors d’une moubaya’a, les tribus de l’ouest l’élisent émir, ou Commandeur des Croyants (suite également au refus de son père d’occuper ce poste, au motif qu’il est trop vieux). Abdelkader réfute le titre de sultan et se contente, en fait, de celui d’émir. Le poste est confirmé cinq jours plus tard à la grande mosquée de Mascara. En un an, grâce à une combinaison de raids punitifs et de politique prudente, l’émir arrive à unir les factions de la région, et à étendre sa zone d’influence à toute la province oranaise. Sa première opération militaire a visé le fort turc car il considérait que les Ottomans comme la source de tous les maux du pays. Puis, le 12 juillet 1834, au combat de Meharaz, près de Tlemcen, son armée écrase celle de l’agha des Douair, Mustapha ben Ismaël, réputée comme la plus puissante de la région. Supplétifs des Ottomans, les Douair constituaient en effet une tribu makhzen, c’est-à-dire une force militaire permanente au service du bey d’Oran.
Le Traité Desmichels ou la ruse contre la ruse
Le général français Louis Alexis Desmichels, commandant en chef local, reconnait Abdelkader comme le représentant principal de la région et, en 1834, il signe avec lui un traité qui cède presque complètement le contrôle de la province d’Oran à l’émir. Le but de Desmichels est d’isoler l’ouest en y confinant Abdelkader afin de permettre à la colonisation de se renforcer au centre. Tacticien, l’émir profite du traité pour renforcer son autorité et s’élever davantage aux yeux de ses concitoyens. Cela lui permet de rallier les tribus du Chelif, de Miliana, de Médéa et de la Mitidja. Voyant Abdelkader prendre plus d’ampleur au lieu de s’isoler, le haut commandement français remplace le général Desmichels par le général Trézel, ce qui provoque une reprise des hostilités. La bataille de la Macta, en juillet 1834, montre un émir tacticien et stratège, puisque cette opération fait plus de 800 morts parmi les 2500 hommes du général Trézel. Au début de 1836, l’expédition commandée par le gouverneur, le maréchal Clauzel, occupe temporairement Mascara et Tlemcen mais sans succès.
D’autres campagnes de pacification permettent cependant à la France de remporter des rencontres militaires importantes, dont la bataille de la Sikkak, avant que le général Thomas Robert Bugeaud ne soit autorisé à utiliser tous les moyens pour inciter Abdelkader à faire des ouvertures de paix. Le traité de la Tafna, signé le 30 mai 1837, donne encore à Abdelkader plus de contrôle sur les parties intérieures de l’Algérie, mais avec la reconnaissance du droit de la France à la souveraineté impériale. Tactique contre tactique, l’émir tente de sauver l’Oranie pour pouvoir sauver l’Algérie comme la France vise à ruser pour se renforcer. Ce traité lui permet de contrôler tout l’Ouest et d’étendre son influence au Titteri, et au-delà. D’ailleurs dans la version arabe du traité de la Tafna, Abdelkader ne reconnaît pas la souveraineté de la France, à l’inverse de ce qui est inscrit dans la version française ; outre le fait qu’elle lui attribue un territoire beaucoup plus vaste que ne le fait la version française.
Sa pensée est claire : « Nous avons assumé cette lourde charge dans l’espoir que nous pourrions être le moyen d’unir la grande communauté des musulmans, d’éteindre leurs querelles intestines, d’apporter une sécurité générale à tous les habitants de ce pays, de mettre fin à tous les actes illégaux perpétrés par les fauteurs de désordre contre les honnêtes gens, de refouler et battre l’ennemi qui envahit notre patrie dans l’espoir de nous faire passer sous son joug. » Ainsi, l’homme de plume, le déjà mystique, qui se destinait à professer devient un homme d’épée, battant même des généraux. Tout en se référant au devoir de guerre sainte, il organise son État et fait diffuser deux fetwa demandées aux Oulema (docteurs) de Fès en 1837, puis en 1840, qui insistent sur le devoir de solidarité des musulmans. Son règne, entre 1834 et 1843, est désigné comme la période du « gouvernement des Chorfa » (littéralement descendants du Prophète), qui a mis fin à « l’époque de l’anarchie » ayant suivi la chute des Ottomans. Abdelkader exige l’obéissance et l’impôt, et s’engage à gouverner « la Loi à la main ». Le luxe est proscrit pour les hommes, conseillés de consacrer l’excédent de leurs ressources à acheter des armes et des chevaux pour la guerre. L’idée de l’État en tête, il crée de toutes pièces une administration, une justice, des finances. Par nécessité de réunir tous les moyens, il interdit le jeu et le vin, et même l’usage du tabac bien qu’il reconnaisse que l’islam n’interdit pas totalement ce dernier, mais estime que cette habitude revient trop coûteuse aux pauvres. Il n’a cependant pas les moyens de mener des réformes comparables à celles des pachas d’Égypte ou même des beys de Tunis. Il a néanmoins pu organiser son État naissant et le diviser en huit khalifaliks, placés sous les ordres de khalifas ou lieutenants. Deux d’entre eux, Ben Allal Ould Sidi Embarek, khalifa de Miliana, et Mustapha Ben Thami, khalifa de Mascara, font preuve de véritables talents militaires.
Usine à poudre et manufacture de canons
La résistance est menée essentiellement par les guerriers des tribus, redoutables combattants, mais l’absence de logistique et de stabilité les rend peu capables d’effort commun et soutenu contre l’occupant. L’impôt vise à permettre la création de forces régulières. D’ailleurs, en très peu de temps, les troupes soldées, encadrées par un corps d’officiers et de sous-officiers, atteignent l’effectif de 8 000 fantassins, organisés en bataillons, 2 000 cavaliers et 240 artilleurs.
C’est une véritable armée qui se crée, d’autant qu’elle reçoit une formation moderne, dispensée par des instructeurs venus des armées régulières de Tunisie, de Tripolitaine, ou des déserteurs de l’armée française, « indigènes ou étrangers », dira plus tard l’émir prisonnier, pour éviter de froisser ses interlocuteurs en insinuant que des Français aient pu déserter, ce qui semble bien avoir été le cas. L’armée de l’émir est équipée de matériel européen, acheté en France, en particulier à l’occasion de la trêve survenue entre 1837 et 1839, ou au Maroc, et de provenance surtout anglaise. La poudre est fabriquée sur place, de même qu’une manufacture de canons et une autre de fusils sont installées quoiqu’elles ne fonctionnent pas longtemps. Cependant, ni ces troupes ni ces infrastructures n’ont le temps de se renforcer, car les colonialistes sont plus avantagés sur tous les plans.
L’affrontement de 1839 s’impose comme moyen pour régler définitivement le problème entre la France et l’émir qui refuse la sujétion à un État chrétien, tandis que de son côté, le gouvernement français prétend à la souveraineté sur l’ensemble de l’Algérie. C’est Abdelkader qui, en novembre 1839, prend l’initiative des hostilités. Le franchissement par un détachement français du défilé des Portes de Fer, près de Bordj Bou Arréridj, dans une zone qui lui a été attribuée par le traité de la Tafna, est l’occasion pour en découdre, estime-t-il. Il sait pourtant qu’il se met en péril, et dira plus tard au général Daumas : « Il m’eût fallu, non pas trois ou quatre ans, mais cent ans, pour être à la hauteur de l’armée française.» Ce réalisme renforce ses capacités de stratège : au départ, il installe l’essentiel de ses ressources sur la ligne la plus reculée du Tell, à Sebdou, Saïda, Tagdempt, Taza, Boghar et Biskra, en bordure des Hautes-Plaines. Afin d’empêcher les Français de s’y maintenir il aurait même songé à détruire les villes de la ligne centrale, Médéa, Miliana, Mascara et Tlemcen. Leur ravitaillement à partir de la côte leur aurait couté de grands efforts, mais le devançant, les colonialistes renforcent leurs effectifs : les villes tombent les unes après les autres : Médéa le 17 mai 1840, Miliana le 9 juin, Boghar le 23 mai 1841, Taza et Tagdempt le 25 mai.
Dépassé, l’émir se voit très vite contraint de renoncer à interdire son territoire aux colonnes ennemies, sa dernière tentative en ce sens ayant consisté à chercher à empêcher, le 12 mai 1840, à la colonne du maréchal Valée de traverser le col de Mouzaïa, point de passage alors obligé entre Blida et Médéa. En dépit de toutes les positions occupées et fortifiées par les siens, la France les conquiert, le persuadant que son combat est celui d’un David contre Goliath. La guérilla devient alors sa stratégie, les batailles classiques étant devenues caduques face à la supériorité numérique et matérielle de l’ennemi. « Nous nous battrons quand nous le jugerons convenable, tu sais que nous ne sommes pas des lâches », écrit-il à Bugeaud en juin 1841. Il ajoute : « Nous opposer à toutes les forces que tu promènes derrière toi, ce serait folie, mais nous les fatiguerons, nous les harcèlerons, nous les détruirons en détail ; le climat fera le reste. […] Vois-tu la vague se soulever quand l’oiseau l’effleure de son aile ? C’est l’image de ton passage en
Afrique. »
La smala, capitale itinérante aux 5000 livres
Abdelkader devient fugitif dans son propre pays, un combattant itinérant avec pour capitale un immense pays : c’est la fameuse smala, qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de personnes. Marches et contre-marches éprouvantes pour les femmes, les enfants, les combattants et lui-même. Les harcèlements contre les troupes coloniales ne donnent que de petites victoires, au prix d’immenses efforts. En mai 1843, une colonne commandée par le duc d’Aumale réussit, presque par hasard, à s’emparer de la smala de l’émir, en l’absence de celui-ci. La smala d’Abdelkader se déplaçait avec 5000 livres et manuscrits rares, c’est dire l’importance qu’il accordait à la culture dans sa conception de l’État. D’autres défaites s’en suivent mais le soldat ne renonce pas, en dépit de ses forces, réduites à un millier de cavaliers, suffisantes cependant pour lui permettre de mener de nouveaux raids contre les territoires occupés par les Français. Des tribus lui fournissent renforts, nourriture, et abri en cas de repli. «On ne sait ce qu’est lui résister, et d’ailleurs, avec ses quinze cents cavaliers, il est plus fort que plusieurs tribus réunies », dit de lui Bugeaud.
En 1845, l’insurrection dans laquelle s’illustre le chérif Bou Maza redonne de l’espoir à Abdelkader qui mène alors des opérations qui vont faire, selon un officier français, le capitaine Cler, « l’admiration de tous les militaires qui ont quelques idées de la guerre ». La suite est connue. L’émir guerrier est doublé d’un humaniste. Bien qu’ayant été contraint à déposer les armes en 1847 pour se voir emprisonné en France puis exiler en Syrie, il demeure un homme de foi et d’humanisme. Il est à Damas, ce jour du 9 juillet 1860, lorsqu’éclate une émeute antichrétienne : au péril de sa vie et de celle de ses proches, il n’hésite pas à prendre la défense des minorités non musulmanes, sauvant ainsi près de 12.000 chrétiens d’une mort certaine. En effet, lorsque des heurts violents opposent Druzes et chrétiens maronites du Mont Liban, le conflit se propage à Damas et des émeutiers s’en prennent aux importantes minorités chrétiennes de la ville. Abdelkader réagit sans attendre. Il monte sur son cheval et parcourt la ville à la tête de sa petite troupe de « Maghrébins ». Intrépide, il ose s’interposer entre les émeutiers et leurs victimes. Il moralise les uns et offre aux seconds un asile dans sa maison. Son action ravive sa popularité en France au point où Napoléon III lui décerne la grand-croix de la Légion d’Honneur.
C’est selon le principe musulman d’« ordonner le louable et dénoncer le blâmable » (al-amr bi al-ma‘rûf wa al-nahy ‘ani al-munkar) qu’il a dit avoir agi ; obéissant, dit-il, à un simple « devoir imposé par la Loi mohamadienne et les droits de l’Humanité ». Voyant l’humanité une et inséparable, Abdelkader, le premier porte parole du dialogue interreligieux et du rapprochement entre les peuples, a dit : « Si les Musulmans et les Chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j’aurais fait cesser leurs querelles ; ils seraient devenus, extérieurement et intérieurement, des frères. » D’ailleurs, une chaire Unesco pour les Droits de l’Homme et la Culture de Paix créée à l’université d’ d’Alger I, le 15 juin 2016. La plaine de Ghriss, que domine Mascara, où est né et a grandi l’Emir Abdelkader, est quadrillée par les koubbas de chrofas et de saints, aïeux vénérés des tribus. C’est elle qui a engendré ce soufi doublé d’un combattant, devenu le vrai père fondateur de la nation algérienne moderne. Même ses ennemis témoignent pour lui en termes élogieux (Maréchal Bugeaud, Maréchal Saint-Arnaud, général Paul Azan, général Duvivier) ainsi que beaucoup de ses contemporains français comme Ernest Renan).
Connu pour ses textes mystiques, l’émir a aussi écrit du ghazal, dans la tradition arabe des odes à l’amour. « J’aime voir la gazelle du désert, observer son ombre quand tombe la nuit ; Je cherche sa proximité, mais elle s’éloigne, et me fuit. / Cette gazelle, infidèle au serment refuse la compagnie du voisin. / Elle se complaît dans la fierté / Elle cultive l’arrogance ; / Grise par sa beauté / Elle ne concède rien / Je la courtise, elle me dédaigne; / Je sollicite l’échange de propos / Elle rejette ma demande / Puis elle me couvre de reproches / Alors le cœur exulte / Car son reproche éteint mes brûlures. » Comme beaucoup d’aèdes d’ici et d’ailleurs, il compare la femme aimée à la gazelle du désert. Se drapant de dignité, elle ne se laisse pas aisément séduire, défendant sa vertu, exigeante.
Ce mystique devenu guerrier a aussi laissé une belle poésie mystique à laquelle Mohamed Souheil Dib a consacré un livre paru aux éditions ANEP où l’auteur traduit et analyse des poèmes de l’Emir. « Lumière sans soleil / Et soleil sans lumière / Mer sans limites / Et rivage sans mer / Inconnu à jamais / Et Connu sans conteste / Autre sans réalité pure / Et réalité pure sans autre / Voile sans dévoilement / Et dévoilement sans voile / Aube sans nuit / Et nuit sans aube / Perplexité mienne et stupéfaction / ultime bord sans le moindre soutien / Tu m’as ébloui, de toute évidence / Dans ma réalité et au-delà de l’éblouissement / Tout être connaissant / Intelligent ou raisonnable, erre perplexe / Nous avons ainsi révélé, au risque de périr / Le but ultime de tout amant », écrit Abdelkader.
A.E.T.