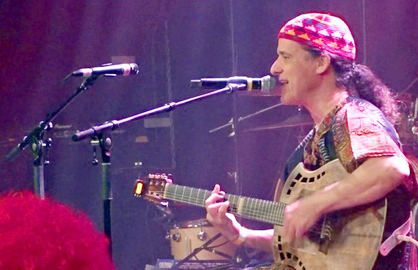Le septième volet de la saga s’annonce comme la sortie la plus rentable de toute l’histoire d’Universal. On fait le point sur les recettes d’une franchise devenue prospère. C’est peut-être triste, mais rien au monde n’est plus fédérateur qu’une équipe fan de bolides, de baston, de flingues et de bimbos. C’est ce que l’on peut constater, chiffres à l’appui, avec la franchise Fast and Furious. Universal a trouvé ici la formule gagnante. Ou plutôt les tickets, car les ventes de ces derniers en salle ont déjà rapporté la bagatelle de 2,3 milliards de dollars avec les six premiers volets. Et puisqu’il vaut mieux ne pas changer pas une équipe qui gagne (les producteurs l’ont expérimenté avec le troisième long métrage), Universal ne prend plus de risques et ne fait que corser une recette déjà juteuse.
En pole position pour faire un nouveau carton, la saga n’a pas toujours été promue à un bel avenir.
Le succès du premier épisode, réalisé avec le minibudget de 38 millions de dollars, a été un succès surprise. Universal avait tiré à la ligne pour réaliser deux films supplémentaires, la sanction était tombée: Fast And Furious: Tokyo Drift, troisième du nom, avait fait un flop. Pour beaucoup, la saga n’avait plus d’avenir. Vin Diesel était alors devenu producteur de la saga et choisissait de muscler les scènes d’actions. En embauchant plusieurs «Monsieur Muscles» (Dwayne Johnson, et plus récemment Jason Statham) ou même des acteurs connus ayant la sympathie du public (Ludacris, Tyrese Gibson) et en assurant la promo du film, les Fast and Furious doivent beaucoup au Baby-Sittor au grand cœur. Après tout, ses fanfaronnades prêtent à sourire, et curieusement, attendrissent. Comme lorsqu’il annonce naïvement à Variety que Fast and Furious 7 «va probablement gagner l’Oscar du meilleur film».