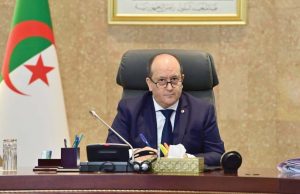Aden est revenue dans le giron loyaliste. Une reconquête qui donne des ailes à la coalition qui ne veut plus entendre de pourparlers. Assiste-t-on à un tournant majeur dans la guerre du Yémen ? C’est probable. En juillet, les rebelles houthis étaient chassés d’Aden, deuxième ville du pays et seul grand port sur la mer d’Arabie. Dans la foulée, cinq provinces du Yémen du Sud étaient libérées par l’armée loyaliste et la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite. Puis ce 16 septembre, le Premier ministre et vice-président du pays, Khaled Bahah, et sept de ses ministres, réfugiés en Arabie saoudite depuis mars, revenaient à Aden. La cité devient officiellement la « capitale provisoire » du pays.
Mais la ville de Rimbaud est partiellement détruite. Les combats de rue y ont été terribles entre avril et juillet. Les trêves n’étaient jamais respectées plus de deux heures entre les houthis et leurs alliés (les militaires restés fidèles à l’ancien président Ali Abdallah Saleh chassé du pouvoir en 2012 par le « Printemps yéménite »), et les forces armées loyalistes du président Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par l’Arabie saoudite et la coalition de neuf pays arabes.
L’objectif du Premier ministre est clair alors que le chef de l’État se trouve encore à Riyad : organiser la résistance populaire pour reconquérir Taëz, troisième ville du pays, au nord-ouest d’Aden. Puis gagner Sanaa, la capitale, où les forces coalisées s’apprêtent à lancer une offensive terrestre à partir de la région de Maarib, au centre.
Sanaa : un objectif plus difficile
Reconquérir le sud du Yémen n’était pas une tâche impossible. Les provinces qui longent la mer d’Arabie, au sud du pays, sont unanimement hostiles aux houthis, cette tribu guerrière et montagnarde chiite, à la frontière de l’Arabie saoudite. Les rebelles sont vus comme une population moyenâgeuse et peu éduquée. Aux antipodes de la population d’Aden, largement laïque et politisée, voire indépendantiste. La région fut une république marxiste dominée par les Soviétiques jusqu’en 1990, année de la réunification des deux Yémen. La reconquête de Sanaa, la capitale, où les houthis sont bien implantés, risque, elle, d’être plus difficile.
Quoi qu’il en soit, en cette mi-septembre, plus personne ne parle de pourparlers de paix ni même de cessez-le-feu. À Genève, en juin, les précédentes négociations avaient échoué. Chaque camp est jusqu’au-boutiste. Le sultan Qabous d’Oman espérait rassembler les protagonistes cette semaine. L’émissaire des Nations unies pour le Yémen, le Mauritanien Ismaël Ahmed Ould Cheikh, avait déclaré avoir l’accord des deux parties : les houthis et les forces loyalistes.
Peine perdue. Le 13 septembre, à Riyad, le président yéménite en exil, Mansour Hadi, annonçait qu’il lançait une grande offensive militaire pour reconquérir la région pétrolière de Maarib (là où Total exploitait des gisements avant la guerre), au nord-est de Sanaa. Hadi déclarait accepter de négocier à deux conditions : que les houthis se retirent des zones conquises depuis février 2015 et qu’ils remettent les armes prises sur les forces de sécurité, comme le demande la résolution 2216 de l’ONU.
Troupes au sol
Pourquoi cette volte-face des loyalistes et de leur soutien saoudien ? Depuis la reconquête d’Aden et des provinces du Sud, ils se sentent le vent en poupe. Pas question de pourparlers alors que les houthis ont perdu du terrain. La coalition arabe se lance même dans une guerre au sol. Depuis mars, la campagne saoudienne se résumait à des bombardements massifs, sans souci d’épargner les vies civiles (5 000 morts en un an, selon l’ONU), dans les zones conquises par les houthis (quartiers résidentiels, marchés, mosquées). Début septembre, des soldats d’élite saoudiens, 1 000 Qataris, 800 Égyptiens sont arrivés pour renforcer les quelques troupes saoudiennes sur place. Des Soudanais devraient suivre. L’émir du Bahreïn a même annoncé que ses deux fils participeraient à la reconquête du Yémen. Une partie de ces soldats remontent du Sud vers Taëz. D’autres, renforcés par de l’armement lourd (chars, lance-missiles) arrivé par la frontière saoudienne, se massent aux environs de Maarib.
Qu’est-ce qui pousse l’Arabie saoudite et neuf pays arabes et musulmans – dont le lointain Maroc et le Pakistan qui n’est pas arabe – à soutenir le pouvoir yéménite contre les Houthis dans cette guerre civile ? En fait, le conflit politico-tribal yéménite a réveillé tous les enjeux et contradictions du Moyen-Orient.
Pré carré
La première raison est proprement saoudienne. L’Arabie saoudite a toujours considéré le Yémen comme son arrière-cour. Une histoire de famille. À Riyad, le dossier yéménite est traité par le prince héritier et non par le ministre des Affaires étrangères. Rien de ce qui se passe à Sanaa ne doit rester étranger aux Saoudiens. Or les houthis qui, en septembre 2014, profitant des turbulences du Printemps arabe, s’installent au pouvoir en chassant le Mansour Hadi, le président choisit par Riyad, ne peuvent laisser les Saoudiens indifférents. Ils sont bien décidés à remettre Mansour Hadi sur son fauteuil. Ils veulent un fidèle à Sanaa. La deuxième raison est religieuse. Les Saoudiens, des wahhabites (sunnites), sont les ennemis irréductibles des chiites. Les houthis sont chiites, très exactement des zaydites, en clair les membres d’une branche du chiisme qui observe un dogme différent du chiisme iranien. Au Yémen, les zaydites représentent un tiers de la population, mais tous ne sont pas des houthis (ceux-ci appartiennent à la même tribu guerrière dont le fief est à Saada). Population montagnarde, royalistes pour certains, ils sont en révolte quasi permanente contre le pouvoir central de Sanaa. Accusé de les laisser tomber. La troisième raison relève de la géopolitique. Les Saoudiens voient dans les houthis, avec lesquels ils se sont affrontés militairement à plusieurs reprises, le bras armé de l’Iran. Riyad craint que la république islamique ne profite de la rébellion houthie pour pousser ses pions au sud de la péninsule arabique et prendre l’Arabie saoudite en tenaille. Or, Riyad et Téhéran, les deux grandes capitales pétrolières du Moyen-Orient, se livrent une guerre larvée de grandes puissances. Chacun veut être le numéro un de la région.
La menace iranienne
L’Arabie saoudite a-t-elle raison d’avoir peur ? Au début des années 2000, certains affirmaient déjà que la rébellion houthie recevait des armes d’Iran via l’Érythrée. Au printemps dernier, lorsque les houthis s’installent au pouvoir à Sanaa, l’Iran n’est pas resté passif. En mars, deux avions ont relié quotidiennement Téhéran à la capitale yéménite. Or les liaisons aériennes étaient suspendues depuis 1990, les deux pays n’entretenant ni relations d’affaires ni échanges d’étudiants…
Pour Riyad, il devenait évident que l’Iran et ses amis chiites voulaient l’encercler. Au nord, les chiites irakiens, au pouvoir à Bagdad ; au sud, les houthis pro-iraniens si le Yémen tombait définitivement dans leur escarcelle. L’inquiétude saoudienne était d’autant plus grande que le pays se sentait fragilisé par l’accord nucléaire en préparation entre l’Iran et les Américains. Riyad passait alors à l’offensive en mars dernier. Et ralliait la quasi-totalité des pays arabes derrière elle. Non seulement l’Arabie saoudite dispose de moyens sonnants et trébuchants, mais les États du Golfe, qui ont tous des minorités chiites, ne sont pas mécontents de leur montrer ce qui pourrait leur arriver si elles bougeaient…
La rébellion houthie peut-elle être matée ? Rien n’est sûr. Dans le passé, elle s’est toujours repliée dans ses montagnes de Saada avant de repartir au combat. C’est dans le sud du pays que la situation est la plus inquiétante. L’État en est absent. Le départ des houthis a créé un vide rempli par les combattants d’Al-Qaïda, ennemis des Houthis et alliés, dans les faits, aux Saoudiens et aux Américains. Le terrain leur appartient. Ils seront plus difficiles à chasser que les fidèles du chef chiite.