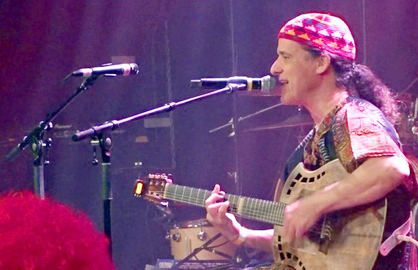Juchée sur un échafaud au milieu d’un carrefour à Bagdad, Wijdan al-Majed fait danser son pinceau sur une fresque murale. L’artiste irakienne casse les codes dans la capitale ultra-bétonnée avec ses représentations de célébrités irakiennes et étrangères, comme Zaha Hadid ou Mère Teresa. Sous la houlette du maire de Bagdad, une quinzaine de fresques ont fleuri sur les murs de la capitale pour rendre hommage à des architectes, poètes, peintres ou intellectuels d’Irak et d’ailleurs dans le monde. Les pieds ballants devant une structure en béton, Wijdan al-Majed apporte quelques touches ocres à la paupière du poète irakien Muzaffar al-Nawab. Accompagnant son portrait, des scènes de vie dans un village représentent des paysannes en habit traditionnel. Ses pots de peinture sont empilés dans un cageot, les brosses et pinceaux de différentes tailles trempent dans l’eau. à leur passage, voitures, motos et tuk-tuks ralentissent pour observer la scène atypique. « Le plus beau des Muzaffar ! », hurle un conducteur taquin. « On apporte de la joie à des lieux abandonnés », dit d’un air amusé l’artiste de 49 ans qui enseigne à la faculté des Beaux-Arts. C’est la première expérience de street-art pour Wijdan al-Majed, plutôt habituée à exhiber ses aquarelles et ses peintures acryliques dans l’atmosphère feutrée des salons d’expositions, souvent fréquentés par les mêmes cercles. Aujourd’hui son art est « ouvert à tout le monde, à toutes les catégories » sociales, s’enthousiasme l’artiste, jean et chaussures tâchés de peinture. « Les artistes, les passants, les vendeurs ambulants, les jeunes et les moins jeunes ».
« La société m’a acceptée »
Les couleurs chatoyantes brisent la monotonie d’une capitale bétonnée et chaotique, où le long des avenues les câbles des générateurs électriques forment d’épais entrelacs. Sur une fresque, regard mystérieux et menton sur la paume, la défunte architecte anglo-irakienne Zaha Hadid pose devant ses réalisations. Tout près, c’est le portrait de Jawad Salim, un des pères de l’art moderne irakien, et même le sociologue allemand Max Weber, entouré de livres. Dans un pays largement conservateur, peindre en pleine rue s’accompagne de « défis importants » pour une femme, reconnaît Wijdan al-Majed. Parfois des employés de la municipalité l’accompagnent pour l’assister sur le terrain. Pour les premières peintures, elle était aidée par un autre artiste, avant de poursuivre le projet seule. « Il m’arrive de rester très tard dans la nuit, parfois jusqu’à minuit, deux heures du matin », raconte-t-elle. « La rue c’est inquiétant, c’est pas évident pour une femme d’y rester jusqu’à ces heures tardives ». Il y a aussi, dans certains cas, les commentaires désobligeants. « Je dois faire avec », concède-t-elle. « Je les entends et je n’y prête pas attention. Eux aussi ont commencé à s’habituer à une femme qui peint ». Une artiste irakienne à Dubaï lui a écrit pour lui dire qu’elle aurait rêvé travailler ainsi à Bagdad, mais qu’elle avait « peur de la société ». « Mais la société irakienne m’a acceptée », ajoute Mme Majed.
« Beauté dans la ville »
L’initiative lancée il y a neuf mois par le maire de Bagdad Alaa Maan vise à faire jaillir « la beauté dans la ville, transposer l’art dans la rue, éliminer la couleur grise, la couleur de la poussière ». L’architecte de formation choisit les personnalités qui sont dessinées. Il reconnaît qu’une capitale de neuf millions d’habitants qui produit jusqu’à 10 000 tonnes de déchets par jour attend aussi de grands projets d’infrastructures, entravés par les grands maux du pays: corruption, gestion hasardeuse des deniers publics et bureaucratie. « La ville est la première victime: tout problème frappant un pays s’y reflète. Quand il y a du chômage, vous verrez des vendeurs ambulants (…) quand il y a une crise du logement, vous verrez des bidonvilles. » Les murs de Bagdad sont d’ailleurs couverts de graffitis partageant espoirs et messages politiques des manifestants mobilisés lors du soulèvement populaire de l’automne 2019. Ils dénonçaient pêle-mêle infrastructures en déliquescence et corruption endémique. Dans le quartier populaire de Sadria, deux vendeurs de pastèques, l’un assis en tailleur, surplombent un rond-point. La reproduction d’un tableau de Hafidh al-Droubi a fait son petit effet. « C’est le patrimoine de Bagdad et de l’Irak », s’émeut Fadel Abou Ali, 63 ans et vendeur de tissus, espérant voir de telles initiatives « se reproduire dans toutes les provinces ». Mais il attend plus des autorités. « Pas que les dessins, pas que les apparences. On veut aussi la propreté dans les rues de Bagdad, le tout-à-l’égout, des jardins publics ».