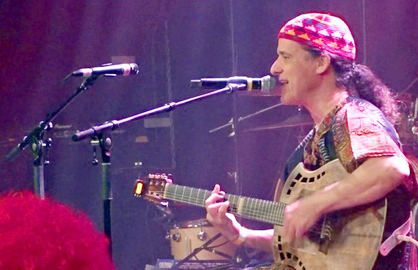Le 8 mai 1945 fut un mardi noir pour les Algériens. Les Français fêtaient la fin de la Seconde Guerre mondiale, où 150 000 Algériens avaient participé, engagés de force certes, dans l’armée aux côtés Du général de Gaulle.
Par Ali El Hadj Tahar
A Sétif, dès 8 heures du matin, une foule estimée aux environs de 10 000 personnes est rassemblée devant la mosquée de la gare, à l’appel des organisateurs musulmans pour revendiquer des doits. Les manifestants se dirigent vers le centre-ville, pacifiques, sans armes, scandant des slogans de paix et de liberté. « Indépendance », « Libérez Messali Hadj », « L’Algérie est à nous ». La foule a aussi pour consigne de brandir pour la première fois le drapeau algérien. La riposte est sanglante alors que les organisateurs ont instamment rappelé aux paysans venus des villages de déposer tout ce qui pouvait être une arme (couteau, hâche, faux…) afin de ne pas donner colonialiste des prétextes de sévir. Derrière les drapeaux des alliés, les écoliers et les jeunes scouts sont au premier rang, suivis des porteurs de la gerbe de fleurs.
A la vue d’un drapeau algérien sorti puis déployé par un manifestant, les policiers attaquent la foule pour s’emparer du drapeau. Un militant explique que l’emblème étant sacré, il était impossible de le remiser ou remettre à qui que ce soit. C’est alors qu’un inspecteur tire, tue celui qui portait ce drapeau tandis que deux coups de feu en soutien de la part d’Européens partent du café de France, suivis par d’autres coups de feu tirés depuis les fenêtres des colons. Le premier martyr est un jeune scout : Saâl Bouzid, 22 ans. Puis le car de la gendarmerie arrive en fonçant sur la foule, fauchant quelques uns au passage. Non contents de tuer des dizaines d’Algériens sur place, les colonialistes commencent un véritable massacre dans une répression qui dure plusieurs jours. Les survivants de la manifestation sont pourchassés, puis la chasse se poursuit contre toutes personnes musulmanes et ce, pendant plusieurs jours. Dans les localités environnantes à Sétif, Ras El Ma, Beni Azziz, El Eulma, des douars entiers sont décimés, des villages incendiés, des dechras et des familles sont brûlées vives. Des nourrissons sont jetés contre les murs, des femmes éventrées… Une milice coloniale est même formée, déployée elle aussi pour massacrer un maximum d’innocents désarmés. La répression va toucher plusieurs villes de l’est du pays, durant tout le mois de mai : Guelma, Kherrata, Constantine. Parmi les manifestants de Sétif se trouve un jeune lycéen, Kateb Yacine. Rares ceux qui ont échappé, comme lui. Son âge, 16 ans, et probablement la profession de son père, avocat, plaidaient pour lui. A Guelma, beaucoup sont moins chanceux : ils sont non seulement exécutés mais finissent brûlés dans des fours à chaux. L’armée française voulait frapper les esprits : perpétrer un massacre à grande échelle, en procédant au regroupement de toutes les populations avoisinant les côtes-est de Béjaïa à Bordj Mira en passant par Darguina, Souk El-Tenine et Aokas, afin de les exterminer.
Pendant une semaine, l’armée française, renforcée par des avions et des chars, se déchaîne sur les populations et tue sans distinction. Toutes les forces de police, de gendarmerie, de l’armée sont mobilisées ainsi que des renforts de CRS et de parachutistes. Le général Weiss, chef de la cinquième région aérienne, ordonne le 13 mai le bombardement de tous rassemblements des civils. Kateb Yacine écrit : « Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n’avaient pas prévu de réactions. Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire… […] On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. » L’auteur de Nedjma ajoute : « C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme».
Un massacre planifié perpétré de sang froid
Cet événement tragique va marquer le jeune Kateb Yacine, en faire un adulte précoce, le doter d’une maturité rare : on le voit dès mai 1947 prendre la parole à Paris dans une « Salle des Sociétés Savantes » où il fait une conférence sur « Abdelkader et l’Indépendance algérienne ». On le voit fréquenter les petits hôtels où vivent les « épaves de la société algérienne en exil », pou se former, se forger au contact des militants ouvriers algériens parqués dans la pauvreté et l’exil… L’entrée brutale dans l’histoire brise le parcours de cet adolescent petit bourgeois indigène qui aurait pu finir avocat come son père, ou interprète ou notaire au meilleur des cas. En 1943, c’était M’Hamed Issiakhem qui volait une grenade dans une caserne : l’arme lui explose dans les bras, il en sort avec un bras en moins mais deux de ses sœurs et une cousine meurent sur le coup. L’écrivain et le peintre se rencontreront en France. C’est dans un même studio, à Paris que nait Nedjma (1956, Seuil), le roman de Karama, surnom que le peintre donnait à son ami écrivain. Karama, pour Karamazov, personnage de Dostoïevski. « À partir de là, la classe ne m’intéressait plus après la prison. Ce qui m’intéressait, c’était la poésie avant tout. Mon père, bien qu’avocat, n’a pas su me dire non. En ce sens, mon arrestation a été bénéfique. Alors, je suis parti… », dit Kateb Yacine dans un entretien paru dans la Revue Dialogues (décembre 1963)), avant d’ajouter : « C’est en prison que j’ai découvert le peuple qui était là devant moi, mais que je n’avais jamais vu jusque là… j’ai découvert là mes personnages. » Cette incarcération sera fatale pour sa mère qui, le croyant mort, perd la raison. Il partira à Bône (Annaba) où une autre aventure commence pour lui et où, en tout cas, il publie son premier livre, Soliloques, poèmes, chez l’Ancienne imprimerie Thomas, et ce en, 1956. À lui seul, ce recueil aurait dû valoir plusieurs grands prix internationaux. Son auteur ne peut être comparé par sa maturité sans égale qu’à Rimbaud ou à Mozart.
Kateb Yacine ne cessera d’évoquer les massacres du 8 mai (interviews, conférences), qui le lient intimement à sa patrie meurtrie. En 1967, il disait : « Je crois que je serais resté un poète obscur s’il n’y avait pas eu la manifestation du 8 Mai 1945 ». 45000 compatriotes massacrés, l’horreur qui s’est abattue sur sa famille, sur le clan à Guelma, autre lieu de naissance et, de surcroit, sa mère tant adorée entrée en folie et vivant l’internement psychiatrique le hanteront pour le restant de sa vie. Cette triple meurtrissure va le propulser, le perturber, le nourrir en même temps, car il l’a vivra comme un acharnement contre lui et une bénédiction à la fois, celle d’être poète, engagé, humaniste, homme juste qui ne craint jamais les injustes, ayant vu les pires criminels tirer sur son peuple, le ratant probablement de quelques centimètres ou de quelques mètres, mais lui ayant fait payer doublement son insolence d’échapper à la mort.
Entre 1946-47, il séjourne à Constantine, fréquente les militants du PPA et prononce des conférences politico-littéraires, puis il débarque à Alger et écrit dans d’Alger républicain, en même temps que Mohamed Dib… Le 8 mai 1945 devient un thème central dans Nedjma, qui commence probablement à jaillir durant sa petite phase de sérénité en tant que journaliste, qui fait même un reportage à la Mecque. Le texte, dont les pages sont agrafées sur le mur du studio que Kateb partageait avec Issiakhem, voit le jour aux éditions du Seuil. Nedjma, c’est l’histoire qui rentre par effraction dans la littérature, une histoire d’amour se mêlant à l’amour de la patrie, car le personnage éponyme, cette sorte de femme fatale est non seulement l’aimée que se disputent plusieurs prétendants mais le symbolise de l’Algérienne et de l’Algérie à la fois.
La mère devenue folle et les 45 000 morts qui hantent l’écrivain
« Le printemps était avancé. Il y a un peu plus d’un an, mais c’était la même lumière ; le jour même, le 8 mai, je suis parti à pied. Quel besoin de partir ? J’étais d’abord revenu au collège, après la manifestation ; les trois cours étaient vides. Je ne voulais pas le croire. J’avais les oreilles semblables à des tamis engorgés de détonations ; Je ne voulais pas le croire. Je ne croyais pas qu’il s’était passé tant et tant de choses. » Lakhdar, un autre personnage perturbé qui peut être l’auteur lui-même, dit sa stupeur devant les massacres du 8 mai alors qu’il a participé à la manifestation en rêveur, en pacifiste : « Ce ne serait pas juste d’aller demander une arme à grand père. » Grâce aux détails et événements vécus, le texte fait du peuple l’acteur historique principal : « Le peuple était partout, à tel point qu’il devenait invisible, mêlé aux arbres, à la poussière, et son seul mugissement flottait jusqu’à moi ; pour la première fois ; je me rendais compte que le peuple peut faire peur. »
Dans Neddjma, Kateb Yacine déconstruit ou reconstruit l’écriture non objective de l’Histoire en histoire romancée qui humanise tout en remettant le peuple à sa juste place, pour faire de la foule et des personnages les véritables forces de la Guerre d’Algérie, alors que le mot guerre n’est presque pas prononcé. « Les cadres flottent. Ils ont laissé désarmer les manifestants à la mosquée, par le commissaire aidé du muphti » Lakhdar en participant actif et exigeant s’interroge sur le vif et pose déjà une question fondamentale : « Contenir le peuple à sa première manifestation massive ? »
Kateb fait du 8 mai 1945 un événement central de l’histoire de notre pays. Les expropriations laissent supposer le niveau de misère et de pauvreté qui taraude les ventres et pousse à la revendication, positive pourtant : « Et la foule se mit à mugir : Attendre quoi ! Le village est à nous, vous les riches, vous couchez dans les lits des français/ Et vous vous servez dans leurs docks./ Nous on a un boisseau d’orge et nos bêtes mangent tout./ Nos frères de Sétif se sont levés. » Un vieux montagnard, en tirant sur la gendarmerie, ose hurler : « J’avais juré vider mon fusil, si y a un fils de sa mère, qu’il me donne des cartouches. » Les manifestants étaient-ils vraiment des manifestants ? Yacine donne des détails essentiels : « Pourquoi diable sont-ils venus avec leurs bestiaux ? » Cela montre que les paysans étaient pacifiques et certains devaient ultérieurement finir leur journée au marché à bestiaux. C’est l’histoire réelle que Yacine décrit : « Le coiffeur Si Khelifa ne hurlait plus. Il râlait. Où peut-il bien être ? » Une phrase pour dire l’atroce, la mort. Et quand il évoque la souffrance de la torture, c’est à travers Lakhdar subissant le supplice de la baignoire et recevant des coups de cravache : « Il ne sentait plus sa tête. Le reste de son corps était apparemment indemne ; seconde par seconde, une douleur lointaine et fulgurante se localisant dans les reins, aux genoux, à la cheville, au sternum, à la mâchoire. » On ne peut penser que le jeune collégien ait pu échapper à la torture, du moins aux coups de fouets.
« Je suis passé à l’étude. J’ai pris les textes./ J’ai caché la vie d’Abdelkader./ J’ai ressenti la force des idées./ J’ai trouvé l’Algérie irascible. Sa respiration …/ La respiration de l’Algérie suffisait […]Je suis parti avec les tracts./ Je les ai enterrés dans la rivière./ J’ai tracé sur le sol un plan…/ Un plan de manifestation future./ Qu’on me donne cette rivière, et je me battrai./ Je me battrai avec du sable et de l’eau./ De l’eau fraiche, du sable chaud. Je me battrai. »
Ce roman n’est pas un document d’historien mais l’histoire y pullule, depuis les lointains ancêtres de Nedjma, le réel constamment croisé avec différentes narrations qui composent cette œuvre à plusieurs pistes. Voici comment est dépeinte la violence de la répression : « Les automitrailleuses, les automitrailleuses, les automitrailleuses, y en a qui tombent et d’autres qui courent parmi les arbres, y a pas de montagne, pas de stratégie, on aurait pu couper les fils téléphoniques, mais ils ont la radio et des armes américaines toutes neuves. Les gendarmes ont sorti leur side-car, je ne vois plus personne autour de moi. » Et dans une conférence il disait qu’« on voyait des cadavres partout, dans toutes les rues… La répression était aveugle ; c’était un grand massacre. […] Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. A Guelma, ma mère a perdu la mémoire… La répression était atroce ».
A.E.T.